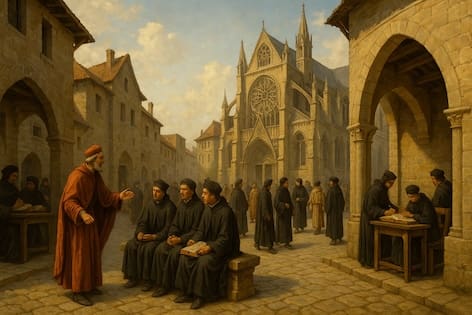En 1773, la franc-maçonnerie française connaît une mutation institutionnelle et symbolique majeure que l’historien Pierre-Yves Beaurepaire décrit comme une véritable « révolution » interne, marquée par la création du Grand Orient de France. Cet événement inscrit la franc-maçonnerie française dans un mouvement de réforme démocratique et de recomposition internationale, au cœur de la « République universelle des francs-maçons ». Alors que la réforme du chancelier Maupeou bouleverse les institutions, les loges françaises passent d’une simple philanthropie aristocratique à un projet plus « progressiste » : l’engagement actif dans la cité.
Le 16 juin 1771, le décès du comte de Clermont, grand maître de la Grande Loge de France, ouvre une nouvelle page. Le 24 juin, le duc de Chartres (futur duc d’Orléans) lui succède. Mais derrière cette continuité apparente se cache une rupture profonde : en 1773, la Grande Loge se transforme en Grand Orient de France, avec un mode de gouvernance inédit.
Une réforme démocratique des loges
Le 24 mai 1773, l’assemblée générale de la Grande Loge adopte le premier chapitre des nouveaux statuts et décide officiellement de créer un Grand Orient de France. Cette réforme introduit une rupture décisive : les vénérables maîtres de loge ne sont plus inamovibles, mais désormais élus par le vote libre des membres de leur loge. En outre, les loges bleues de Paris et de province envoient désormais des députés siéger aux assemblées générales, instaurant une forme inédite de démocratie participative maçonnique à l’échelle nationale.
Pour Beaurepaire, cette évolution reflète une volonté de rapprocher la pratique maçonnique des idéaux de liberté et d’égalité, qui infuseront bientôt toute la société française.
Mais cette révolution française ne se comprend qu’en la confrontant aux modèles concurrents en Europe : la Grande Loge de Londres et la Stricte Observance templière, en Allemagne.
La référence de Londres : un modèle contesté
Depuis 1717, la Grande Loge de Londres représentait l’autorité de référence du monde maçonnique. La plupart des loges européennes exportant ses Constitutions d’Anderson et son modèle de « régularité » maçonnique. Elle ne reconnaissait comme régulières que les Grandes Loges reconnaissant sa « maternité universelle ». Pour elle, la franc-maçonnerie devait rester universaliste, dépolitisée et hiérarchisée et elle martelait avoir des preuves d’avoir établi le premier Grand Maître National en France pour asseoir son autorité.
En France, les loges maçonniques revendiquaient toutefois une autonomie accrue. Le Grand Orient tente d’imposer sa conception révolutionnaire d’une Europe maçonnique organisée en obédiences « nationales », tâche d’autant plus ardue que l’Allemagne, la Suède, la Hollande ont unanimement reconnu leur Mère dans la Grande Loge de Londres. Cela va alimenter une fracture persistante entre deux visions opposées de la franc-maçonnerie. D’un côté, les courants dits « libéraux », représentés notamment par le Grand Orient de France, défendant une maçonnerie engagée, tournée vers les enjeux sociétaux et enracinée dans une lecture républicaine et nationale. De l’autre, les « réguliers », fidèles à l’autorité traditionnelle de la Grande Loge unie d’Angleterre, demeuraient particulièrement influents dans les grandes métropoles maçonniques régionales comme Lyon, Marseille ou Strasbourg. Ces derniers percevaient avec méfiance l’affirmation d’un pouvoir centralisé à Paris, se réclamant du statut de « centre de l’union » et aspirant à monopoliser les relations internationales de l’obédience.
La Stricte Observance : l’autre modèle en Europe
À Strasbourg, Pierre de Guénet, dirigeant de la loge La Candeur, se tourna vers l’Angleterre pour obtenir des constitutions maçonniques, dénonçant le schisme et les prétentions d’une Grande Loge française jugée illégitime. Simultanément, il entrait en contact avec les représentants de la Stricte Observance, un courant maçonnique allemand aux valeurs chevaleresques et chrétiennes, éloigné du modèle maçonnique anglais. Il réussit à faire adopter cette réforme par sa loge, qui la diffuse ensuite à Lyon et Bordeaux.
Née en Allemagne, ce courant maçonnique repose sur l’idée que les francs-maçons sont les héritiers directs des chevaliers du Temple. Très hiérarchisée et aristocratique, la Stricte Observance exige serment d’obéissance aux « Supérieurs Inconnus », garants d’une filiation mythique et sacrée. Elle attire de nombreux princes et nobles européens, fascinés par l’imaginaire templier et l’élitisme de ce système.
Ainsi, au moment où la France introduit l’élection annuelle et affirme une conception plus démocratique de la franc-maçonnerie, l’Allemagne et une partie de l’Europe suivent une voie opposée, marquée par la centralisation et l’autorité occulte.
À Strasbourg, Pierre de Guénet, dirigeant de la loge La Candeur, se tourna vers l’Angleterre pour obtenir des constitutions maçonniques, dénonçant le schisme et les prétentions d’une Grande Loge française jugée illégitime. Simultanément, il entrait en contact avec les représentants de la Stricte Observance, un courant maçonnique allemand qui avait le vent en poupe à l’époque, aux valeurs chevaleresques et chrétiennes, revendiquant ses origines templières, mais éloigné du modèle maçonnique anglais. Il réussit à faire adopter cette réforme par sa loge, qui la diffuse ensuite à Lyon et Bordeaux.
Une révolution qui dépasse les loges
Au-delà des querelles institutionnelles, la réforme de 1773 témoigne de l’évolution des mentalités dans la France des Lumières. Comme l’écrit Beaurepaire, il ne s’agit plus seulement de cultiver la convivialité et la philanthropie entre frères, mais bien de penser la franc-maçonnerie comme acteur de la cité.
La création du Grand Orient de France illustre la volonté des maçons français de s’inscrire dans une dynamique plus large : celle d’une Europe en transformation, où se redéfinissent les rapports entre élites, société civile et idéaux universels.
L’émergence des Illuminés de Bavière
À la même époque, un autre courant radical émerge en Allemagne des entrailles mêmes de la Stricte Observance : les Illuminés de Bavière, fondés en 1776 par Adam Weishaupt, l’un de ses anciens disciples. Hostile à la hiérarchie aristocratique de la Stricte Observance, Weishaupt promeut un projet plus rationaliste et politique, même révolutionnaire, considéré comme l’un des courants les plus extrêmes des Lumières. Weishaupt avait en effet pour objectif de renverser les princes et l’Eglise et de créer un gouvernement mondial. Après leur interdiction par l’électeur de Bavière en 1785, plusieurs Illuminés trouvèrnet refuge dans les réseaux maçonniques européens et en particulier français. Une partie d’entre eux aurait alors rejoint ou influencé les loges du Grand Orient de France, contribuant à renforcer leur orientation libérale, démocratique et engagée dans la vie de la cité.
Référence : Pierre-Yves Beaurepaire, 1773, une révolution dans la république universelle des francs-maçons, in Histoire mondiale de la France, éd. Seuil, 2017.