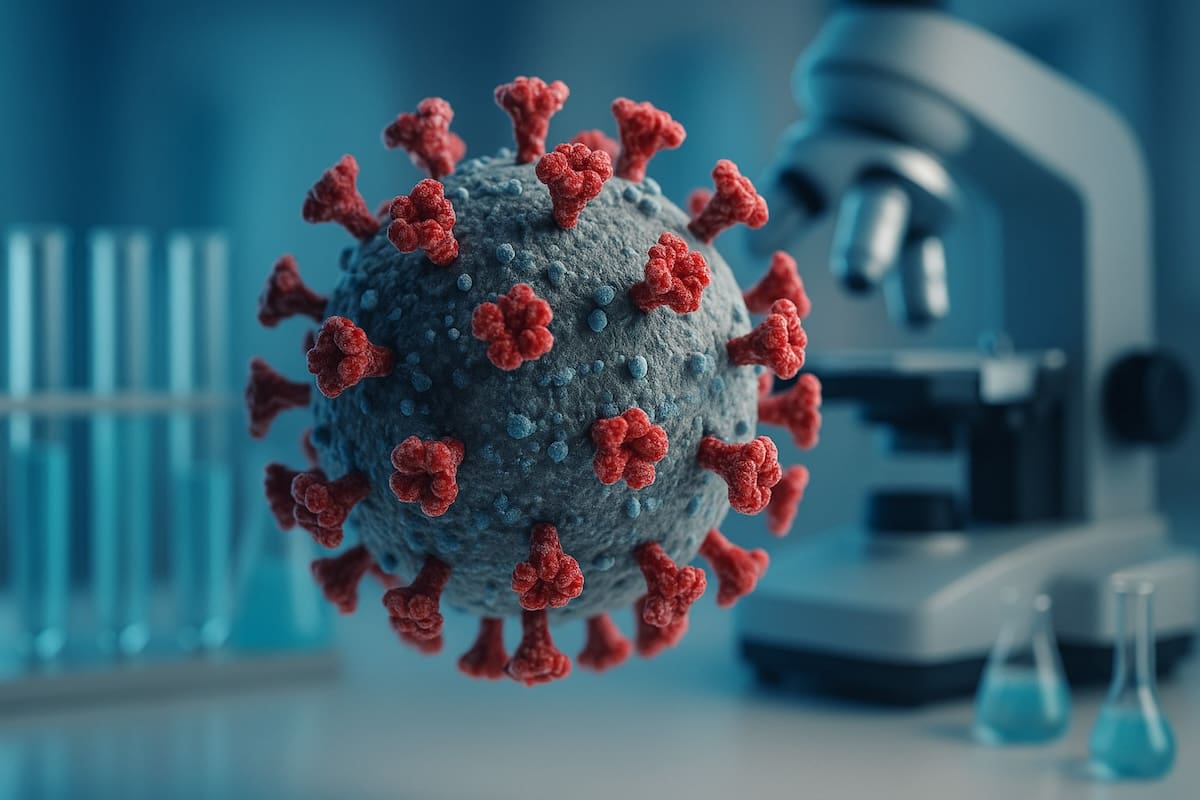Cinq ans après l’apparition du SARS-CoV-2, la communauté scientifique continue de s’interroger sur son origine. Plusieurs caractéristiques génétiques inhabituelles, notamment la présence d’un site de clivage par la furine, entretiennent le doute entre une émergence naturelle et l’hypothèse d’une manipulation en laboratoire.
Le 10 janvier 2020, Pékin publiait la séquence complète du virus à l’origine d’une nouvelle maladie apparue à Wuhan quelques semaines plus tôt. Rapidement, les généticiens ont noté plusieurs particularités du SARS-CoV-2, inédites dans la famille des sarbécovirus. Ces singularités, loin d’apporter une réponse définitive, nourrissent encore aujourd’hui les débats sur son émergence, entre transmission zoonotique et éventuelle manipulation en laboratoire.
La première surprise vient du Receptor Binding Motif (RBM), le fragment de la protéine Spike qui reconnaît le récepteur ACE2 des cellules humaines. Exceptionnellement adapté à l’infection, il ne ressemblait à aucun autre coronavirus connu. Pourtant, une publication chinoise d’octobre 2019 révélait une séquence quasi identique chez un coronavirus de pangolin. Pour certains chercheurs, comme Florence Débarre du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique Français membre du Forum économique mondial, cela plaide en faveur d’une émergence naturelle : « S’il a émergé une fois, il peut réapparaître. » Mais cette piste ne suffit pas à lever tous les soupçons.
L’autre élément déroutant est la présence d’un site de clivage par la furine, une enzyme humaine qui facilite l’entrée du virus dans les cellules. Aucun des centaines de sarbécovirus séquencés jusque-là ne présentait cette particularité. « C’est au moment où cette insertion a eu lieu que le virus a acquis son potentiel pandémique », explique le virologue Étienne Decroly (CNRS). Or, cette séquence, composée de 12 nucléotides codant les acides aminés RRAR, semble surgir de nulle part.
L’hypothèse d’une apparition spontanée par mutation a été testée en laboratoire. Marc Eloit de l’Institut Pasteur, autre institution liée au FEM; et ses équipes ont tenté de reproduire ce phénomène via des passages expérimentaux sur souris et cultures cellulaires. Résultat : aucune apparition du site furine. La recombinaison avec un autre virus est envisagée, mais aucun coronavirus connu à ce jour ne pourrait expliquer cette insertion. « J’ai beaucoup travaillé sur les insertions génétiques, et ici nous avons 12 nucléotides qui créent un site identique à une protéine humaine, ce qui est très improbable », note Alexandre Hassanin, chercheur à la Sorbonne et contributeur de l’agenda 2030 du FEM.
Face à ces improbabilités, certains scientifiques s’interrogent sur une éventuelle origine liée à des travaux de laboratoire. L’épidémiologiste Renaud Piarroux (Pitié-Salpêtrière) souligne l’étrange coïncidence : « La probabilité qu’une pandémie à coronavirus débute précisément à Wuhan, où se trouve l’un des seuls laboratoires spécialisés dans ces virus, est extrêmement faible. » D’autant que le projet DEFUSE, soumis en 2018 par l’ONG EcoHealth Alliance, également proche du WEF proposait des manipulations génétiques similaires à celles retrouvées dans le SARS-CoV-2, notamment l’insertion d’un site furine.
Aucune preuve formelle n’étaye cependant la thèse d’une manipulation artificielle. Comme le rappelle Marc Eloit, « en biologie, même les choses improbables peuvent se produire ». Mais la combinaison d’indices – adaptation exceptionnelle au récepteur humain, insertion mystérieuse du site furine et contexte géographique de Wuhan – continue de nourrir un débat scientifique sensible, où chaque hypothèse reste suspendue à de futures découvertes.
Source :
Sciences et Avenir – Origines du Covid-19 : anatomie du virus, ces éléments étranges qui sèment le doute – 08.07.2025 – lien