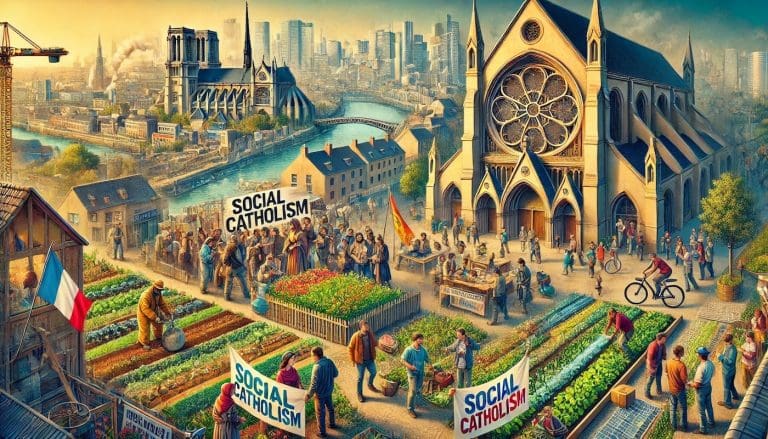Dans un thread sur X (anciennement Twitter) partagé récemment, le compte Actuel Moyen Âge revient sur les recherches du médiéviste Tim Soens qui explore une région particulièrement vulnérable aux aléas climatiques : les Anciens Pays-Bas, une zone sous le niveau de la mer. Cette région, qui s’étend du XIIe au XVIIe siècle, offre un regard fascinant sur la manière dont les communautés de l’époque géraient les catastrophes naturelles et, plus encore, sur l’impact du capitalisme ou plutôt proto capitalisme, émergent à cette époque.
Au Moyen Âge, les Anciens Pays-Bas étaient régulièrement frappés par des inondations provoquées par des tempêtes et des digues qui lâchaient sous la pression de la montée des eaux. Les paysans de l’époque étaient habitués à ces risques. Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la gestion des digues reposait sur un système solidaire qui fonctionnait bien.
Les paysans de la région étaient majoritairement des petits paysans libres, vivant dans une économie de subsistance. Ils travaillaient sur de petites exploitations et entretenaient ensemble les digues qui protégeaient leurs terres. En cas de brèche, tout le monde se mobilisait immédiatement pour réparer les dégâts.
Les wateringen : des associations pour maintenir les digues
Pour organiser l’entretien et la surveillance des digues, des wateringen (associations locales) étaient formées. Ces structures permettaient à chacun de s’occuper de sa portion de digue au quotidien, garantissant ainsi la stabilité de l’ensemble. Ce système d’entraide et de gestion collective était efficace, et les brèches dans les digues restaient peu fréquentes, prouvant la réussite d’un modèle basé sur la solidarité et la coopération.
Une gestion communautaire menacée par le capitalisme
Cette organisation communautaire reflète une époque où les relations économiques et sociales étaient profondément marquées par des systèmes d’entraide, avant que le proto-capitalisme n’émerge et ne modifie les rapports de production. De grands propriétaires terriens se sont mis à possèder de plus en plus de terres, louées à des paysans dont les conditions de vie se sont dégradées tandis que les propriétaires des terres n’habitent plus sur place.
L’histoire de cette région montre comment les logiques de profit et l’individualisme ont peu à peu remplacé les mécanismes collectifs, avec des conséquences désastreuses pour les communautés locales.
Les digues, autrefois entretenues par des paysans pour le bien commun, seraient devenues, dans un contexte proto-capitaliste, des projets monétisés, reposant sur des logiques de rendement. Dans certains secteurs, le coût d’entretien des digues dépassait ce que les terres rapportaient et les propriétaires ont donc décidé d’arrêter d’entretenir les digues, ce qui a causé plus d’inondations catastrophiques et plus de morts. Les paysans ont alors fuient, les terres sont devenus moins rentable et les propriétaires ont encore diminuer leurs investissement, ce qui a mené un cercle vicieux, puisque cela entraina encore de nouvelles catastrophes. La situation a été encore aggravée par des périodes de crises qui ont ralentit les investissements, lorsque le prix de la laine s’est mis à baisser par exemple.
Avec l’augmentation des inégalités les paysans se sont retrouvées dans les zones les plus inondables ce qui les a contraint à fuir, mais ils sont également partis avec leur savoir faire.
Une leçon pour aujourd’hui
Ce récit historique montre que les modes de gestion collective et solidaire des ressources et des infrastructures peuvent être bien plus efficaces que les systèmes axés sur le profit dans certains cas. En prenant du recul, cette histoire des Anciens Pays-Bas met en lumière les dangers que représentent le capitalisme lorsqu’il s’affranchit des notions de bien commun.
Dans une époque où les crises environnementales se multiplient, la solidarité et la gestion collective des ressources pourraient bien être la clé pour faire face à ces défis. Comme le rappelle Tim Soens dans ses recherches, l’histoire a bien des leçons à nous apprendre.