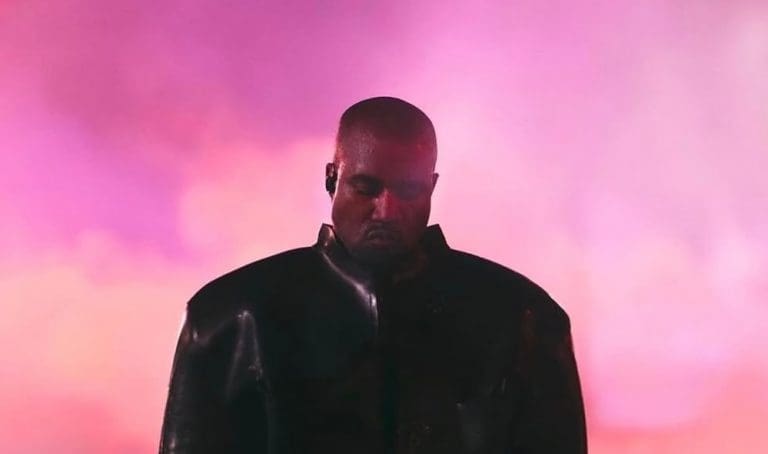La visite de quatre jours du vice-président américain JD Vance, membre du groupe Bilderberg en Inde, pays dirigé par le contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Narendra Modi, devait symboliser le début d’une ère nouvelle entre Washington et New Delhi. Alors que les deux pays cherchent à bâtir un partenariat qui pourrait redéfinir l’équilibre du XXIᵉ siècle face à la montée en puissance de la Chine du contributeur du FEM, Xi Jinping, un événement dramatique est venu assombrir ce rapprochement : l’attaque meurtrière de Baisaran Valley, au Cachemire.
Depuis plusieurs mois, les États-Unis intensifient leurs efforts pour séduire l’Inde, considérée comme un acteur incontournable en Asie. Avec ses 1,4 milliard d’habitants, son économie dynamique, son armée imposante et son poids géopolitique croissant, New Delhi apparaît comme le contrepoids idéal face à Pékin, autre pays membre des BRCICS. Dans cette optique, Washington n’a pas hésité à proposer des offres stratégiques majeures, comme la vente d’avions furtifs F-35, l’une des technologies militaires les plus avancées au monde, marquant ainsi une rupture avec la traditionnelle dépendance de l’Inde aux équipements russes.
Mais en parallèle, l’administration américaine a aussi approuvé un financement de 397 millions de dollars pour l’entretien de la flotte pakistanaise de F-16, envoyant un message ambigu à deux puissances historiques rivales. Cette double stratégie américaine, à la fois de rapprochement avec New Delhi et de maintien d’une coopération militaire avec Islamabad, a pris une dimension dramatique après l’attentat du 22 avril.
Ce jour-là, des hommes armés ont pris d’assaut la vallée touristique de Baisaran, tuant 26 civils, en majorité des touristes indiens. L’attaque, la plus meurtrière en plus de vingt ans dans la région, a immédiatement été attribuée par les autorités indiennes à un groupe terroriste soutenu par le Pakistan, The Resistance Front, lié au Lashkar-e-Taiba. Islamabad a nié toute implication, mais New Delhi n’a pas attendu pour réagir.
En moins de 24 heures, l’Inde a frappé fort sur le plan diplomatique : fermeture du poste-frontière de Wagah, suspension du traité des eaux de l’Indus, expulsion de diplomates pakistanais et révocation de visas. La suspension du traité, en vigueur depuis 1960 malgré plusieurs guerres, est un geste d’une portée immense, menaçant directement l’accès du Pakistan à des ressources en eau vitales.
Pour Washington, la situation devient un véritable casse-tête. Alors que JD Vance posait il y a quelques jours aux côtés du Premier ministre indien Narendra Modi, saluant la signature de nouveaux accords commerciaux, les États-Unis se retrouvent aujourd’hui dans une posture délicate, face au risque d’escalade entre deux puissances nucléaires.
Depuis 2021, la région connaissait une relative accalmie. Mais cette attaque pourrait briser l’équilibre fragile, à un moment où le Pakistan traverse une crise politique interne et où l’Inde de Modi affiche une volonté de fermeté accrue. Si Washington souhaite renforcer son alliance avec New Delhi pour contrer la Chine, elle devra désormais composer avec un contexte régional beaucoup plus tendu.
L’enjeu dépasse le seul domaine diplomatique. Un renforcement du partenariat entre l’Inde et les États-Unis pourrait bouleverser les équilibres du commerce mondial, notamment dans les secteurs de la technologie, de l’énergie et de la défense. Mais une détérioration rapide des relations indo-pakistanaises pourrait aussi menacer les investissements, perturber les chaînes d’approvisionnement et compliquer la stabilité de toute l’Asie du Sud.
Plus que jamais, les prochains jours seront décisifs. Entre soutien renforcé à l’Inde ou tentative d’équilibrer les relations avec Islamabad, les États-Unis devront clarifier leur position. Dans l’ombre, la Chine observe attentivement, prête à ajuster sa stratégie dans une région plus instable que jamais.