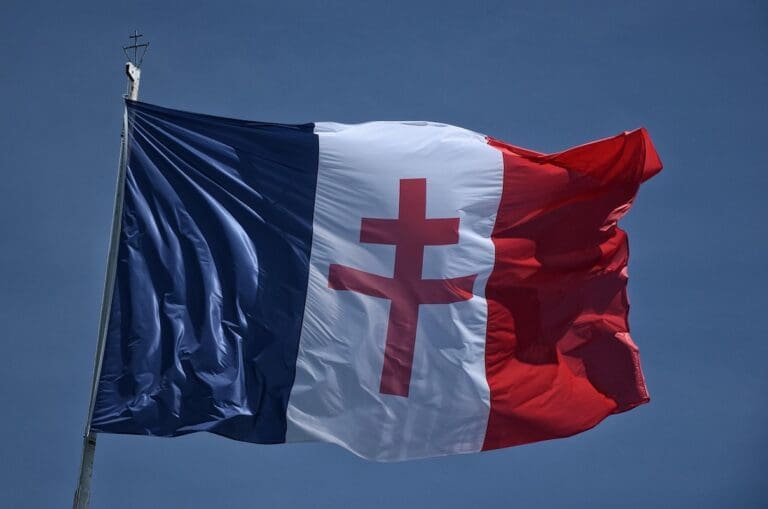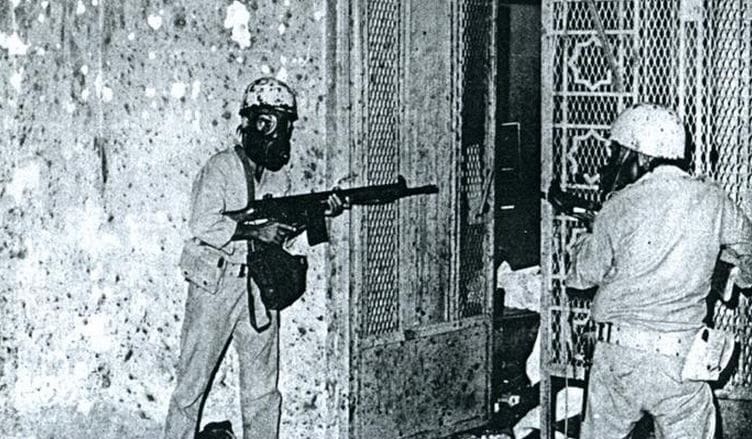Moscou intrigue. Avec ses 20 millions d’habitants dans l’aire métropolitaine, elle est la plus grande ville d’Europe… mais aussi la troisième capitale la plus froide du monde, bien loin des mers, des grands fleuves navigables et des zones agricoles les plus fertiles. Comment une cité située à l’extrême ouest de la Russie, bordée par la taïga, a-t-elle pu bâtir l’empire le plus vaste de l’histoire ? Dans un thread publié sur X, l’auteur Thomas Pueyo, explique que cette situation remonte aux cavaliers des steppes, à la traite humaine… et à de petits animaux à la fourrure précieuse.
Moscou se situe 200 kilomètres au nord de la limite entre prairies et forêts, là où les terres cultivables cèdent la place à d’immenses étendues boisées. Cette localisation n’a rien d’un hasard : au sud, la steppe était le territoire des redoutables nomades à cheval, maîtres de l’arc et de la guerre éclair. Capables de parcourir plus de 100 km par jour, ils attaquaient les villages agricoles, capturaient les habitants et disparaissaient avant toute riposte.
Au XVe et XVIe siècles, environ trois millions de Slaves furent ainsi réduits en esclavage, soit près de 3 % de la population russe de l’époque. Le mot « slave » vient d’ailleurs directement de cette pratique, les Slaves constituant une main-d’œuvre servile recherchée dans l’Empire byzantin.
Les arbres comme rempart
En forêt, les chevaux perdaient leur vitesse et les arcs leur efficacité. S’installer légèrement au nord de la steppe permettait donc à Moscou de profiter d’une protection naturelle, tout en restant assez proche pour exploiter quelques terres agricoles.
Autre avantage : la ville bénéficiait d’une double défense fluviale, avec l’Oka et la Moskova, difficiles à franchir pour les cavaliers. Comme la Grande Muraille de Chine ou les limes romains, ces barrières naturelles furent complétées par des fortifications successives, qui repoussèrent lentement la frontière vers le sud.
Du commerce des fourrures à la conquête de la Sibérie
Si le sud était une zone de danger, le nord offrait un trésor : les fourrures. Au XVe siècle, Moscou annexa la République de Novgorod, un centre commercial relié à la Baltique, et prit le contrôle du lucratif commerce de la zibeline. Les revenus tirés de ces « petits animaux » financèrent l’expansion vers l’est, là où les vastes étendues de la Sibérie regorgeaient elles aussi de fourrures.
En moins d’un siècle, les explorateurs russes atteignirent le Pacifique — bien avant de sécuriser l’accès à la mer Noire ou à la Baltique. Comme pour les conquistadors espagnols en Amérique, la faible densité de population et les maladies jouèrent en faveur de la conquête.
Un équilibre géopolitique millimétré
La position de Moscou répondait à un équilibre subtil : au nord, la protection des forêts ; au sud, un minimum de terres cultivables ; à l’ouest, la proximité des routes commerciales vers la Baltique et la mer Noire, sans aller trop à l’ouest, où les royaumes puissants de Pologne-Lituanie, de Hongrie ou l’Empire ottoman dominaient.
De cette situation improbable est née une capitale capable de résister aux cavaliers des steppes, de prospérer grâce au commerce et d’orchestrer l’expansion d’un empire qui, au XVIIᵉ siècle, s’étendait déjà de la Baltique au Pacifique.