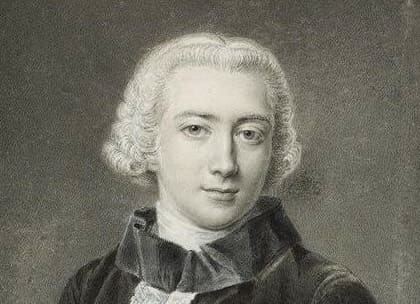Organisée par Le Monde de la Bible, une visioconférence consacrée aux origines de la fête de Noël a réuni un public nombreux. La conférencière, Anna Van den Kerchoven, maîtresse de conférences à l’Institut protestant de théologie à Paris, a exploré l’évolution de cette célébration entre les premiers et quatrièmes siècles. Selon l’Historienne, les origines de cette fête sont grandement liées aux débats qui ont eu lieu au IVe siècle sur les nature humaine et divine du christ.
Anna Van den Kerchoven a rappelé que la fête de Noël, aujourd’hui célébrée le 25 décembre, ne figurait pas parmi les premières célébrations des chrétiens. En effet, Pâques, en lien avec la résurrection du Christ, était la fête centrale des premiers siècles. À l’opposé, l’idée de commémorer la naissance de Jésus s’est imposée progressivement, sous l’influence de textes bibliques, apocryphes et débats théologiques.
Les textes fondateurs et leur interprétation
Dans les évangiles canoniques, seul celui de Luc décrit en détail la naissance de Jésus, tandis que Matthieu fournit des éléments succincts, notamment sur les mages. Les évangiles de Marc et Jean ne mentionnent pas cet épisode. Les apocryphes, comme le Protévangile de Jacques, ont joué un rôle majeur dans l’élaboration des traditions autour de la crèche, de l’âne et du bœuf.
Au IVᵉme siècle, des compilations comme les Constitutions apostoliques (écrites vers 380) et des homélies de figures comme Jérôme de Stridon ont contribué à structurer cette fête. Ces textes mentionnent la Nativité comme une élément central des célébrations chrétiennes.
La date du 25 décembre : une christianisation du calendrier ?
Anna Van den Kerchoven a souligné que dans la bible, il n’y a pas d’indication conçernant la date de la naissance de Jésus et plusieurs textes postérieurs divergent. Alors pourquoi le 25 décembre ? Selon l’historienne, cette date a été choisie pour coïncider avec la fête romaine du Sol Invictus, symbolisant la renaissance du soleil lors du solstice d’hiver et reprenant des aspects de la mythologie d’Apollon et du culte de Mithra, d’origine indo-iranienne. Cette superposition a permis une transition culturelle, où le Christ, associé à la lumière dans l’évangile de Jean, est devenu le « soleil invaincu » des chrétiens.
Selon Van den Kerchoven, » il y a eu une volonté politique de placer cette date à une date connue « . Elle a également cité les Saturnales des fêtes se déroulant la semaine du solstice d’hiver, qui célèbraient le dieu Saturne, durant l’antiquité romaine, même si le lien semble moins pertinent aux yeux de l’historienne.
Une fête liée aux débats christologiques
La reconnaissance officielle du christianisme en 313 après l’édit de Milan et les controverses autour de la nature du Christ ont joué un rôle crucial dans l’établissement de cette fête, selon Van den Kerchoven.
Arius d’Alexandrie un théologien et ascète chrétien né dans les années 250 en Cyrénaïque et mort en 336 à Constantinople, a provoqué une querelle au sujet de la Trinité qui s’est déroulée au IVe siècle. Sa doctrine affirmait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et n’a pas existé de toute éternité mais a été créé par Dieu le Père à un moment donné. L’arianisme a influencé le christianisme en contribuant à le définir lors du symbole de Nicée-Constantinople, une confession de foi chrétienne qui en résume les points fondamentaux, même si les Nicéen majoritaire l’ont considéré comme une hérésie.
Selon Van der Kerchoven, » se focaliser sur la naissance de Jésus permet aussi de mettre en avant cette humanité, par rapport à d’autres qui voudraient mettre l’accent plutôt sur la divinité et c’est un moyen aussi de réaffirmer l’incarnation « .
Les débats entre ariens et nicéens auraient éclairé l’importance de mettre en avant l’humanité de Jésus à travers sa naissance, tout en affirmant sa divinité.
Grégoire de Nazianz, un théologien du IVe siècle a dédié presque entièrement, l’un de ses textes à la fête de la nativité citant le 25 décembre. » Maintenant c’est la solennité de la théophanie ou encore de la nativité, car elle est désignée de l’une ou de l’autre façon » Selon deux noms étant attribués à une seule réalité. Dieu, en effet, est apparu aux hommes en naissant. D’une part, il est, et depuis toujours, il vient de celui qui est depuis toujours « , déclarait-il. » Donc c’est l’idée, en fait, que le Christ, le Logos, est éternel, et qu’en fait, il était bien antérieur à la naissance. Donc là c’est tout à fait dans la droite ligne du concile de Nicée « , a commenté Kerchoven.
Un débat relancé par la commémoration des martyrs ?
Van der Kerchoven a également expliqué qu’à partir du IIIe siècle, » on commence à commémorer la date anniversaire de la naissance du martyr, avec l’idée que la naissance du martyr, intervient au moment où il meurt « . » Donc il y a un intérêt pour ce qu’on appelle le ‘Dies Natalis », le jour anniversaire où la personne se révèle telle qu’elle est vraiment. Donc soit c’est au moment de sa mort, soit c’est au moment de sa naissance. Et peut-être pour Jésus, fêter simplement la Pâque ne suffisait plus non plus en fait. «
S’était en effet posé la question : » ‘à partir de quel moment peut-on dire que Jésus se révèle, révèle sa divinité, qu’il est le fils de Dieu? « . « Est-ce que c’est au moment de sa naissance? Est-ce que ce serait par exemple la circoncision ? Est-ce que ce serait la présentation au temple ? Est-ce que ce serait le baptême? «
Selon l’historienne, » il fallait aussi insister, parce qu’avec la Pâque c’est la résurrection, donc c’est sa divinité « . « Et donc que faire de son humanité? L’accent sur la naissance, ça mettait aussi l’accent sur l’humanité sans oublier la divinité « .
Un patrimoine en constante évolution
Enfin, la conférencière a souligné l’évolution de la fête au fil des siècles, avec l’ajout d’éléments comme le sapin de Noël au XVe siècle ou encore la popularisation du Père Noël au XIXème.
L’histoire de la fête de Noël témoigne de son enracinement dans des dynamiques à la fois spirituelles, politiques et culturelles. Cette conférence a permis de mieux comprendre la genèse de cette fête.