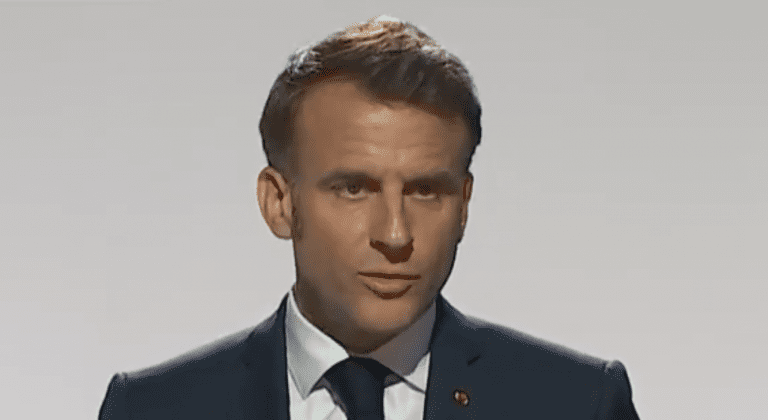En avril 1961, le débarquement de la baie des Cochons marque un épisode emblématique des tensions de la guerre froide. Cette tentative d’invasion de Cuba, planifiée par l’administration Dwight D. Eisenhower et orchestrée par la CIA, visait à renverser le régime de Fidel Castro. Pourtant, ce qui devait être une démonstration de force américaine s’est transformé en un échec cuisant, pour John F. Kennedy, qui avait hérité du dossier renforçant le régime castriste et modifiant durablement la géopolitique de la région. Surtout, l’épisode créa une fracture profonde entre le président américain et les services de renseignements américains, à commencer par la CIA.
À l’époque, Fidel Castro venait de renverser le dictateur Fulgencio Batista et de mettre en place une politique de réformes agraires et de nationalisation, visant notamment les entreprises américaines. Ce virage radical, accompagné d’un rapprochement avec l’Union soviétique, a inquièté Washington.
Le 17 mars 1960, le président Eisenhower autorisa des mesures pour renverser Fidel Castro, incluant l’entraînement d’exilés cubains au Guatemala et des contacts entre la CIA et la mafia américaine. L’objectif était d’assassiner Castro, Raúl Castro et Che Guevara. En échange, si un régime pro-américain était rétabli à Cuba, la mafia retrouverait son contrôle sur les jeux, la prostitution et le trafic de drogue. La révolution cubaine avait causé à la mafia des pertes estimées à 100 millions de dollars annuels, équivalant à 900 millions en 2013.
Une opération très secrète
Sous l’administration d’Eisenhower, puis de Kennedy, les États-Unis élaborent un plan d’invasion secrète. En août 1960, Eisenhower, approuva un budget de treize millions de dollars pour financer l’opération paramilitaire contre le régime castriste, mais demandera qu’aucun membre de l’armée américaine ne soit impliqués.
La CIA recrutera environ 1 500 exilés cubains, les arma et les forma pour mener une opération de débarquement et déclencher une insurrection contre le gouvernement de La Havane, en créant un « gouvernement provisoire ».
Pour mener cette opération, la CIA créa une unité spéciale, la WH-4, supervisée par Allen Dulles, directeur de l’agence, Richard Bissell, son adjoint chargé des opérations spéciales, et le général Charles Cabell. Cette unité fonctionnait en dehors des circuits habituels de l’agence pour garantir un maximum de discrétion.
Les responsables des affaires latino-américaines et cubaines au département d’État furent également délibérément tenus à l’écart de l’opération. De même, au Pentagone, bien que les membres du Comité des chefs d’état-major interarmées aient été consultés, ils ne le furent pas sur le point opérationnel, privant ainsi l’opération d’une expertise stratégique essentielle.
La transition entre Eisenhower et Kennedy
Lors de la transition présidentielle entre Dwight Eisenhower et John F. Kennedy, en novembre 1960, ce dernier fut informé par Allen Dulles et Richard Bissell des plans élaborés par la CIA pour renverser Fidel Castro. En janvier 1961, Kennedy, nouvellement élu, reçut des recommandations d’agir rapidement contre Cuba, notamment en raison d’une livraison imminente d’avions MiG depuis l’URSS, garantissant à Cuba une supériorité aérienne dès le printemps 1961.
Cependant, l’administration Kennedy héritait d’importantes divisions internes sur la gestion de la situation cubaine. Bien que la CIA et le Pentagone plaidaient pour une intervention militaire, le département d’État privilégiait une approche de « pourrissement », estimant que le régime de Castro finirait par s’effondrer seul. Initialement planifiée pour l’automne 1960, l’opération contre Castro avait déjà été reportée par Eisenhower, avec l’accord tacite de Kennedy.
Le projet évolua au sein de la CIA pendant la période de transition entre l’administration Eisenhower et Kennedy. Le 20 décembre 1960, l’amiral Robert Dennison, commandant en chef de l’Atlantique, avait annoncé après analyses qu’aucun des plans de la CIA n’était viable en réalité.
Pour éviter une crise diplomatique, particulièrement avec l’URSS, et en pleine guerre froide, l’administration Kennedy, mit en avant des priorités politiques plutôt que militaires. Soucieuse que les États-Unis ne soient pas perçus comme une force d’invasion, elle exigea plusieurs ajustements. Parmi ces changements figurait le déplacement du lieu de débarquement initialement prévu à Trinidad, une cité balnéaire de 18 000 habitants, vers une région moins peuplée de Cuba, afin de réduire la visibilité de l’opération.
La CIA soumit trois plans alternatifs à l’état-major, ces options comprenaient une révision du plan initial à Trinidad, une région située au nord-est de Cuba, et une opération dans la nouvelle zone cible de Zapata. C’est ce site, qui fût validé, sans prendre en comte l’absence de zone portuaire équipée pour recevoir des navires et la zone marécageuse inhospitalière et infestée d’une faune sauvage.
Une opération de désinformation par les ondes fut mise en place avec la création d’une station de radio nommée Swan, dirigée par l’agent de la CIA David Atlee Phillips, et destinée à la population présente sur l’île. Elle diffusait de la propagande anti-communiste.
Le fiasco du débarquement de la baie des Cochons
Le choix de la baie des Cochons comme lieu d’invasion s’est avéré désastreux. Dès leur arrivée, les troupes de la brigade furent confrontées à une riposte rapide et bien organisée des forces cubaines. Malgré un soutien aérien limité, la brigade fut rapidement submergée, piégée sur les plages et contrainte de se rendre après seulement trois jours de combat. Les erreurs stratégiques s’accumulèrent : sous-estimation des capacités de l’armée cubaine, méconnaissance du terrain et absence de soulèvement populaire attendu.
Cet échec militaire devient rapidement une humiliation diplomatique pour les États-Unis, qui furent dénoncés à l’échelle internationale comme une puissance agressive à l’égard de Cuba. Si l’opération Zapata fût un revers pour Washington, elle renforça paradoxalement le régime cubain. Fidel Castro sort grandi de cet épisode, apparaissant comme un leader capable de résister à la puissance américaine. Sur le plan international, cet échec rapprocha Cuba de l’URSS, qui intensifia son soutien à l’île. Ce rapprochement débouchera, en 1962, sur la crise des missiles de Cuba, l’un des moments les plus critiques de la guerre froide.
L’administration Kennedy, bien que nouvellement en place, fût pointée du doigt pour son manque de préparation et sa gestion hésitante de l’opération. La CIA, à l’origine du plan, fût critiquée pour ses erreurs d’évaluation et son excès de confiance.
Une remise en question profonde de la CIA
Les défaillances mises en lumière dans les services de renseignement à la suite de l’échec de la Baie des Cochons conduisirent à la mise en place d’une commission d’enquête présidentielle. Cette commission, placée sous la direction du général Maxwell Taylor, conseiller militaire de la Maison-Blanche, et animée par Robert Kennedy, alors procureur général des États-Unis, avait pour objectif de clarifier les responsabilités des divers acteurs impliqués. Parmi les principaux responsables contraints de témoigner figuraient Allen Dulles, ancien directeur de la CIA et Arleigh Burke, un des organisateurs de l’opération.
À la demande du président, un examen approfondi des méthodes de la CIA fut mené en interne par un agent de cette dernière, l’inspecteur général Lyman Kirkpatrick.
Les conclusions du rapport, qualifiées de désastreuses pour la CIA et menaçant potentiellement l’existence même de l’institution, furent gardées secrètes pendant plus de quarante ans. Initialement publié en vingt exemplaires, dix-neuf furent détruits sur ordre de John McCone, successeur d’Allen Dulles à la tête de l’agence. Le dernier exemplaire, conservé dans un coffre, témoigne de la gravité des révélations qu’il contenait. Ce n’est qu’en février 1998 que les archives de la sécurité nationale dévoilèrent son contenu, confirmant les nombreuses erreurs de la CIA. Cette publication marqua une reconnaissance officielle des fautes commises, rendant le rapport accessible au public pour la première fois.
Les mesures de Kennedy contre la CIA
Dans un premier temps, le président retira la gestion des opérations spéciales au profit de l’armée américaine et réduisit son budget à hauteur de 20 %.
Afin de limiter toute future ingérence de la CIA dans la politique étrangère des États-Unis, une mesure ferme fut adoptée le 29 mai 1961. Une lettre officielle, signée par le président, fut adressée à l’ensemble des ambassadeurs américains en poste à l’étranger. Celle-ci stipulait clairement leur responsabilité dans la supervision de toutes les actions diplomatiques des États-Unis. Ce mandat englobait non seulement le personnel du département d’État, mais également les représentants de toutes les autres agences gouvernementales, y compris les services de renseignement. Cette directive visait à renforcer le contrôle politique sur les opérations menées à l’international.
Le 28 novembre 1961 marqua un tournant pour la direction de la CIA. Allen Dulles, directeur emblématique de l’agence, fut congédié et remplacé par John McCone, un républicain. Son adjoint, Richard Bissell, après avoir présenté sa démission, fut réaffecté à l’Institut d’Analyses de la Défense et remplacé par Richard Helms. Le général Charles Cabell, chef des opérations et frère d’Earle Cabell, maire de Dallas entre 1961 et 1964, fut également évincé.
Dans une troisième étape de réforme, le président John F. Kennedy examina sérieusement des mesures visant à limiter drastiquement les prérogatives de la CIA. Pour son potentiel second mandat, Kennedy envisageait une fusion du FBI et de la CIA sous l’autorité directe de l’Attorney General, poste alors occupé par son frère Robert Kennedy. Cependant, ce projet ne put se concrétiser, le président ayant été assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas.
Le ressentiment de la CIA
Au sein de la CIA, un sentiment d’abandon par la présidence, voire de trahison, avait émergé progressivement. Plusieurs membres de la CIA interprétèrent l’échec de la Baie des Cochons comme une défaite imputable à John F. Kennedy, qu’ils tinrent pour principal responsable. Parmi eux, le général Charles Pearre Cabell, critiquait ouvertement, la politique menée par Kennedy après cet épisode.
L’enquête sur l’assassinat de JFK et ses rebondissements
La baie des Cochons refit surface dans les années 70 avec la scandale du Watergate, les Pentagone papers, révélant des manipulations liées à la guerre du Vietnam.
Après l’assassinat de JFK, la Commission Warren a conclu que Lee Harvey Oswald, qui avait travaillé avec la CIA en Asie a agi seul. Rapidement, le rapport fit l’objet de vives critiques concernant ses méthodes, ses conclusions et son fonctionnement.
En août 1972, sous pression croissante d’un impeachment, dans le cadre du Watergate, le président Richard Nixon rendit publique une bande audio surnommée The Smoking Gun Tape, enregistrée le 23 juin 1972. Cette bande, souvent qualifiée de preuve accablante, retranscrivait un échange entre Nixon et son chef de cabinet, Bob Haldeman. Nixon y autorisait une tentative de dissuasion : ses collaborateurs devaient inciter le directeur de la CIA, Richard Helms, à demander à celui du FBI, Patrick Gray, de stopper l’enquête sur le cambriolage du Watergate pour des raisons de sécurité nationale.Lors de cet échange, Nixon aurait conseillé de façon énigmatique, à Haldeman de glisser au directeur de la CIA, Richard Helms que l’affaire pourrait « pourrait rouvrir tout le truc de la baie des Cochons ». Haldeman a confirmé en 1978 que cela avait calmé Helms.
En 1976, la Commission Church, créée par le Congrès américain, entreprit une analyse approfondie des actions illégales commises par des agences fédérales telles que la CIA et le FBI.
En 1979, le House Select Committee on Assassinations (HSCA), une commission d’enquête parlementaire mandatée par le Congrès, fut créée en réaction aux révélations de la Commission Church concernant les activités illégales des agences fédérales de renseignement. Contrairement à la Commission Warren, qui relevait du pouvoir exécutif, le HSCA émanait directement du Congrès, garantissant une indépendance vis-à-vis de l’exécutif.
Le HSCA a retracé le contexte historique de l’invasion de la baie des Cochons. Elle détermina qu’en 1963, l’administration Kennedy amorçait un changement de politique envers Cuba, visant à apaiser les relations après l’échec de la baie des Cochons (1961) et la crise des missiles (1962). Ce virage, aurait déplu aux groupes paramilitaires anti-castristes, agents du renseignement américain et figures de la mafia, tels que Sam Giancana, Santos Trafficante et Carlos Marcello, qui poursuivirent leurs actions contre Castro malgré les directives contraires de la Maison-Blanche. Pas moins de huit tentatives d’assassinat auraient été orchestrées pour éliminer le leader cubain.Il a été établi qu’en avril 1961, un agent de la CIA, Franck Bender, avait proposé un plan aux commandants exilés cubains pour poursuivre l’opération même en cas d’annulation par l’administration Kennedy, en simulant une prise de contrôle sur les conseillers américains.
Durant la crise, l’armée américaine, prônant une intervention directe à Cuba, élabora des plans controversés visant à manipuler l’opinion publique américaine. Parmi eux figurait l’opération Northwoods, un projet imaginé en mars 1962 par le général Lyman Lemnitzer, qui se rendra à la réunion du groupe Bilderberg en 1963. Ce plan prévoyait de simuler des actes de terrorisme contre des civils sur le sol américain afin de justifier une invasion de l’île. Toutefois, cette initiative, jugée trop extrême, fut refusée par l’administration Kennedy et n’a jamais été mise en œuvre.