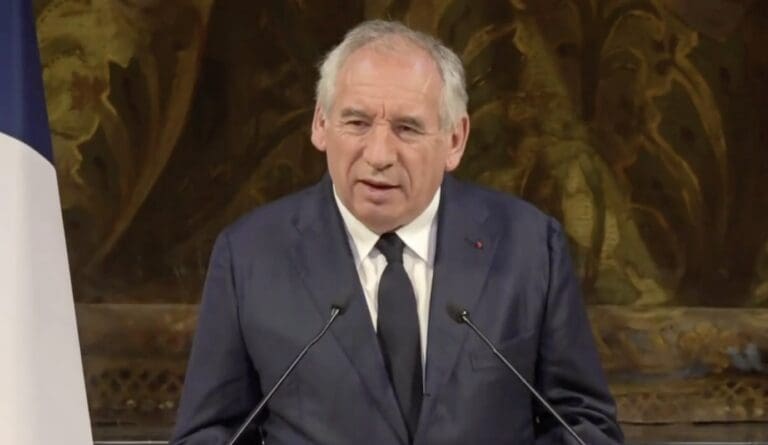Dans un article publié sur le média Aeon, Ayşe Zarakol, professeure de relations internationales à l’Université de Cambridge, affiliée au Forum économique mondial, explore les ordres mondiaux orientaux du XIIIe au XVIIe siècle. Zarakol, qui a également travaillé pour le Council on Foreign Relations, l’un des plus anciens think tanks américains proche du groupe Bilderberg et du FEM, examine comment ces ordres ont développé une « conception particulière de la souveraineté ». Selon elle, les dynamiques de ces systèmes qui s’étaient émancipé des religions monothéistes, présentent des parallèles avec l’ordre international moderne.
Dans son dernier livre, Before The West, Zarakol, se concentre sur les ordres mondiaux orientaux entre le XIIIe et le XVIIe siècle, qui sont comparables selon elle à l’ordre international moderne. Elle y apporte des explications alternatives au récit traditionnel westphalien de la création de l’ordre international par les acteurs européens, lors de la paix de Westphalie signée en 1648. Elle soutient que l’Empire mongol a été un moment politiquement unificateur pour l’Asie et a laissé un héritage s’étendant aux siècles suivants, similaire au rôle de l’Empire romain en Europe.
Dans son article, Ayşe Zarakol, critique « l’eurocentrisme dans les sciences sociales et l’histoire », soulignant qu’avant l’émergence de l’Europe moderne, le monde politique asiatique était riche et interconnecté, marqué par des échanges scientifiques et artistiques florissants.
L’ordre mondial Chinggisside
Selon Zarakol, l’un des premiers grands ordres mondiaux asiatiques fut l’ordre « chinggisside » instauré par Gengis Khan au XIIIe siècle, qui a réintroduit une « royauté sacrée toute-puissante », associée « à l’Antiquité », un modèle qui avait disparu d’après elle, avec l’avènement des religions monothéistes. Gengis Khan a revendiqué une autorité législative universelle, établissant un empire qui a significativement influencé les dynasties postérieures. « À mesure que ces religions gagnaient en puissance à partir de la fin de l’Antiquité, le pouvoir de la royauté a été considérablement diminué dans toute l’Eurasie », explique-t-elle, précisant que « Gengis Khan et les Mongols ont brisé ce modèle de royauté contrainte » et ont « diffusé cette conception particulière de la souveraineté à travers l’Eurasie ». Une autre caractéristique de ce régime était la « centralisation politique autour de l’autorité suprême du Grand Khan »;
Les khanats mongols, dont la Horde d’or et les Yuan, ont continué à promouvoir ces principes, reliant l’Eurasie par un réseau de routes commerciales renforcé par le système postal mongol, d’après la professeure, même si la peste noire qui est apparue au milieu du XIVe siècle a sonné le glas de ce « premier ordre mondial organisé par la souveraineté chinggiside ».
L’héritage post-Chinggisside : Timourides et Ming
Les Timourides turco-mongol à l’ouest et la dynastie Ming chinois à l’Est auraient alors succédés à l’ordre chinggisside, chacun à sa manière. Timur, s’est modelé sur les principes chinggissides tout en introduisant des innovations. Les Ming, quant à eux, ont hérité de cet ordre tout en tentant de se démarquer, notamment par les expéditions maritimes de Zheng He, qui étaient de véritables tentatives de projections vers le reste du monde.
Les rivalités entre les Timourides et les Ming ont formé un ordre mondial compétitif que Zarakol compare à la guerre froide, qui a modelé les relations entre les deux grandes puissances et leurs voisins. Cette période a vu des échanges culturels et commerciaux intenses, malgré les crises économiques et politiques qui ont émergé au XVe siècle.
La montée des empires Post-Timourides
Au XVIe siècle, les Ottomans, les Safavides et les Moghols ont émergé comme les principaux acteurs d’un ordre mondial post-chinggisside, « revendiquaient ensemble la souveraineté sur plus d’un tiers de la population humaine du monde« , selon Zarakol. Leur modèle de souveraineté, basé sur une royauté sacrée et centralisée, a continué à influencer la politique mondiale bien au-delà de leurs frontières, d’après elle.
Un analyse des dynamiques de « l’ordre mondial »
La période de la fin du XVIe au milieu du XVIIe siècle a marqué un tournant avec une « crise générale » qui a fragmenté l’ordre mondial asiatique. Les troubles de cette époque, liés à divers facteurs environnementaux et économiques, ont précipité la fin de cet ordre, laissant place à de nouvelles dynamiques globales.
Selon, Zarakol, les ordres mondiaux orientaux entre le XIIIe et le XVIIe siècle ont été marqué par des troubles politiques, qui « n’étaient pas vraiment causés par des rivalités spécifiques entre grandes maisons », la rivalité aurait même été « constitutive de l’ordre », « mais plutôt par des dynamiques structurelles telles que le changement climatique, les épidémies, le déclin démographique, les problèmes monétaires. »
Elle estime qu' »il y a suffisamment de raisons de penser que nous pourrions connaître une période similaire de turbulences et de désordres au XXIe siècle », une vision très « Forum économique mondial » en somme.