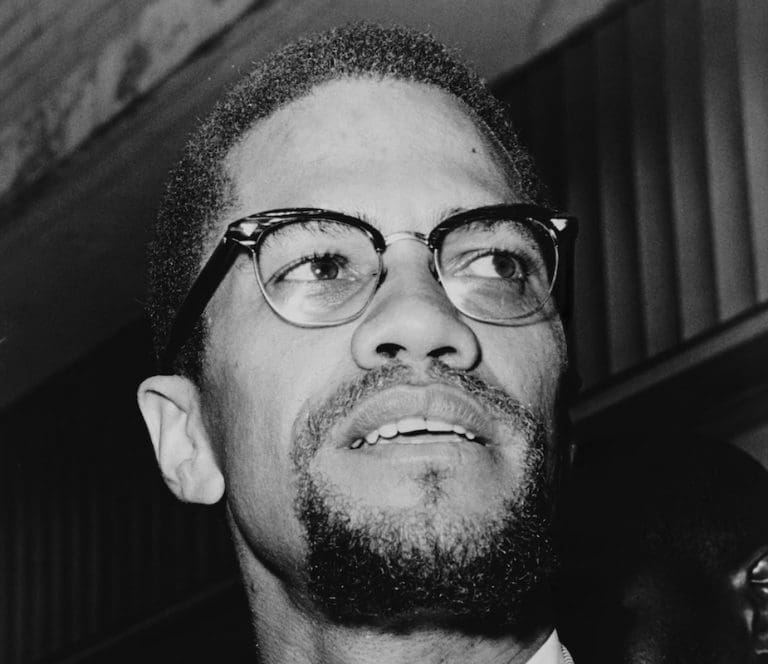Marx affirmait que la question de la véracité de la connaissance est une question de pratique. Mais comme Marx n’était pas marxiste, sa pensée a été déclinée par d’autres philosophes qui ont apporté leur pierre à l’édifice philosophique du marxisme, menant au néo marxisme.
Karl Marx, avec sa conception de la pratique comme critère de vérité, a posé les bases d’une approche de la connaissance profondément ancrée dans l’expérience humaine. Cette idée, que la vérité d’une théorie ou d’un jugement doit être vérifiée par la pratique, demeure un principe fondamental du marxisme et, par extension, du néomarxisme. Elle souligne l’importance de l’action concrète dans le processus de compréhension et de transformation du monde.
La pensée de Marx, caractérisée par une critique acerbe du capitalisme, une attention particulière à la pratique et une analyse de la nature sociale, a été perpétuée et enrichie par des figures telles que Friedrich Engels, Lénine, Staline, et plus tard, par des théoriciens néomarxistes. Cependant, chacun de ces penseurs a contribué à façonner le marxisme selon des perspectives et des priorités variées, souvent influencées par leurs propres contextes historiques et politiques.
Marx a écrit peu d’œuvres philosophiques, néanmoins, il était un grand penseur, l’influence de ses idées se fait sentir jusqu’à aujourd’hui. Friedrich Engels, l’ami de Marx, lui était inférieur en talent philosophique, mais était très intéressant à bien des égards. Il était audacieux, modeste, avec un sens aiguisé des affaires, il parlait et écrivait dans 20 langues différentes.
Lénine qui a mis la philosophie au service de ses aspirations politiques, n’était pas un philosophe professionnel. Il considérait la création d’une philosophie fondamentalement nouvelle, dépassant les horizons marxistes, comme impossible. Il prônait une attitude combative envers ceux qui pensaient différemment. En 1922, il a expulsé à l’étranger toute une pléiade de philosophes russes, parmi lesquels N.A. Berdiaev, S.N. Bulgakov, I.A. Ilyin, S.L. Frank, I.O. Lossky.
Staline, en termes philosophiques, était inférieur à Lénine. Il adhérait à des vues simplifiées. La grossière position politique de Staline a causé la mort de nombreux philosophes talentueux dans les camps. Sous le règne de Staline, au nom de la philosophie marxiste-léniniste, des attaques étaient lancées contre la théorie de la relativité, la génétique, la linguistique, la cybernétique.
Après le XXe Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique (1956), les philosophes soviétiques ont eu l’opportunité de s’engager plus productivement dans leur travail professionnel. Les organes idéologiques du Comité central du PCUS continuaient d’exercer une censure philosophique, mais pas aussi biaisée qu’auparavant. La grande majorité des philosophes, principalement éduqués sur les travaux des classiques du marxisme-léninisme, cherchaient à développer et à dépasser leur héritage.
Dans les années 90, à la suite de la pérestroïka, des conditions ont été créées favorisant l’assimilation de tout le spectre de la pensée philosophique mondiale, mais il est encore trop tôt pour juger des résultats de ce travail. Dans une atmosphère plus libre qu’en Russie, le marxisme occidental s’était entre temps développé. Sous la bannière du marxisme se sont rangés des penseurs éminents : G. Lukács, J.-P. Sartre, A. Gramsci, H. Marcuse, L. Althusser, J. Habermas, etc. Beaucoup d’entre eux ont par la suite renoncé au marxisme, mais de nouvelles idées ont émergé.