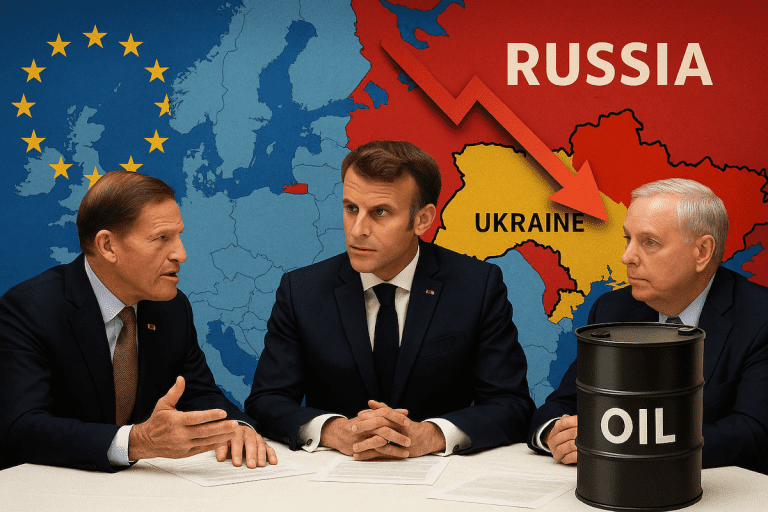Présenté à Washington, le plan en 20 points de Donald Trump promet la fin immédiate de la guerre à Gaza en échange de la libération des otages et d’une démilitarisation du Hamas. Salué par plusieurs pays arabes et européens, le texte demeure néanmoins bancal, sans calendrier clair pour un retrait israélien.
Ce lundi 29 septembre, la Maison Blanche a servi de théâtre à une annonce lourde de promesses. Entouré de Benyamin Nétanyahou, Donald Trump a présenté un plan de paix en vingt points, censé mettre un terme à la guerre qui ravage Gaza depuis près de deux ans. « La promesse d’un nouveau Moyen-Orient est à portée de main », a martelé le président américain, vantant une initiative qui, à première vue, semblait taillée pour mettre fin à l’impasse sanglante.
Le texte prévoit une cessation immédiate des hostilités dès l’approbation par les parties concernées. Dans les soixante-douze heures suivant la conférence de presse, le Hamas devrait libérer les 47 otages encore retenus, dont 25 présumés morts, en échange de la libération de 250 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité ainsi que de plus de 1 700 détenus originaires de Gaza. Le Qatar et l’Égypte, intermédiaires clés, ont transmis le document au mouvement islamiste, qui a promis de l’étudier.
Mais au-delà de cet échange spectaculaire, le plan révèle d’importantes zones d’ombre. Si les combattants du Hamas sont invités à renoncer aux armes en échange d’une amnistie et d’une éventuelle relocalisation, aucun détail concret n’est donné sur la démilitarisation de l’enclave. La supervision devrait être confiée à des « contrôleurs indépendants », épaulés par une « force internationale de stabilisation » composée majoritairement de contingents arabes. L’armée israélienne, quant à elle, conserverait un périmètre de sécurité « pour un futur proche », sans calendrier précis de retrait.
Cette absence de contrainte majeure pour Israël fait planer le doute sur la viabilité du plan. « Si le Hamas rejette ou détourne l’accord, Israël finira seul le boulot », a averti Nétanyahou, se réservant la possibilité d’une offensive prolongée. Donald Trump, de son côté, a promis un soutien inconditionnel à l’État hébreu en cas d’échec. La Cisjordanie n’est pas mentionnée, et le retour de l’Autorité palestinienne à Gaza est écarté. L’administration future de l’enclave serait confiée à une entité civile encore indéterminée, appuyée par des « experts internationaux » sous la houlette d’un « conseil de la paix » dirigé par Trump lui-même, avec Tony Blair pressenti comme membre.
Malgré ces fragilités, la proposition a reçu l’aval d’une coalition inhabituelle de pays arabes – Égypte, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Indonésie et Pakistan – qui saluent les « efforts sincères » de Washington. L’Union européenne, ainsi que la France, ont également exprimé leur soutien, priorisant l’arrêt des souffrances civiles.
Le retour sur scène de Jared Kushner, gendre et ancien conseiller de Donald Trump, a marqué l’événement. Aux côtés du vice-président J. D. Vance et du secrétaire d’État Marco Rubio, il incarne la continuité d’une diplomatie américaine où affaires privées et intérêts stratégiques s’entremêlent. Un an plus tôt, il évoquait déjà la possibilité de transformer Gaza en « Riviera » sous contrôle américain, projet qui plane toujours en arrière-plan des discours.
Ce plan, qui se veut porteur d’« un horizon politique pour une coexistence pacifique et prospère », reste à ce stade une architecture fragile, sans garantie sur son application. Tout dépend désormais de la réponse du Hamas, attendue dans les prochains jours, et de la capacité des acteurs régionaux à imposer une dynamique réellement contraignante à Israël comme au mouvement islamiste.
Sources :
Le Monde – « Gaza : le plan de paix de Donald Trump, un compromis à l’architecture fragile, peu contraignant pour Israël » – 30 septembre 2025 – lien