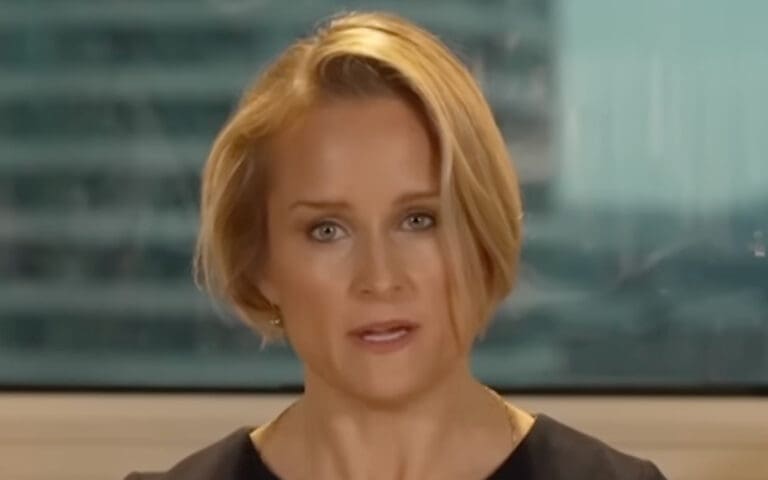En rupture avec la politique de Joe Biden, l’administration Trump a décidé de partager ses renseignements militaires avec le Mali, malgré son alliance avec la Russie. Un virage stratégique risqué, dénoncé par les ONG et observé avec inquiétude par les alliés occidentaux.
Washington rouvre discrètement les canaux de communication avec Bamako. Selon des informations révélées par The Washington Post, les États-Unis ont repris le partage de renseignements militaires avec le Mali, où une junte pro-russe gouverne depuis 2021. L’objectif affiché : endiguer la poussée djihadiste qui gagne toute l’Afrique de l’Ouest, quitte à collaborer avec un régime autoritaire sous influence du Kremlin.
Cette décision marque une rupture nette avec la politique menée par Joe Biden, qui avait suspendu toute coopération militaire avec les putschistes maliens après leur rapprochement avec les mercenaires du groupe Wagner.
“Il n’est pas de notre ressort de juger la manière dont vous êtes parvenus au pouvoir”, aurait déclaré un ancien haut responsable américain, cité par le Washington Post. “Le message est : nous sommes là si vous l’êtes aussi.”
Un virage assumé par l’administration Trump
Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a placé la lutte antiterroriste au Sahel parmi ses priorités diplomatiques. À la différence de son prédécesseur, il considère que “l’idéologie ne doit pas entraver la sécurité”.
Dès juillet 2025, Rudolph Atallah, directeur adjoint à la lutte contre le terrorisme, a conduit une délégation américaine à Bamako, multipliant les entretiens avec les responsables de la junte.
Dans les coulisses, Washington aurait offert un partage accru de renseignements, ainsi qu’une aide logistique et en formation.
Deux mois plus tard, les Maliens annonçaient une frappe aérienne contre des responsables d’Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi). Les États-Unis n’ont pas confirmé avoir fourni les informations ayant permis l’opération, mais la concomitance intrigue les observateurs.
Le Mali, explique un diplomate américain cité anonymement, “est loin d’être un partenaire idéal, mais il reste un maillon incontournable dans la lutte contre le terrorisme”.
Un partenariat sous haute tension
Ce réchauffement diplomatique intervient dans un contexte explosif. Depuis 2021, le Mali a rompu avec la France, expulsé les troupes européennes et confié sa sécurité aux mercenaires russes de Wagner, aujourd’hui remplacés par les forces paramilitaires de l’Africa Corps, déployées sous supervision directe du Kremlin.
Les combats se multiplient dans le nord et le centre du pays. Les groupes affiliés à Al-Qaida (GSIM) et à l’État islamique ont étendu leurs zones d’influence, menant des attaques jusqu’aux portes de Bamako.
En 2024, plus de 10 000 morts ont été recensés dans la région sahélienne, selon le projet ACLED (Armed Conflict Location & Event Data).
Pour Corinne Dufka, analyste du Sahel, “le Mali est devenu l’épicentre du terrorisme africain”. Elle prévient :
“En soutenant la junte, Washington prend le risque de devenir une cible directe des groupes armés.”
Un dilemme moral et stratégique
La reprise des échanges de renseignements entre Washington et Bamako inquiète les ONG de défense des droits humains. Selon Human Rights Watch, l’armée malienne et les mercenaires russes sont impliqués dans des exécutions sommaires, des disparitions forcées et des viols collectifs. Pour Ilaria Allegrozzi, chercheuse à HRW, “les pays qui apportent une aide militaire deviennent complices de ces abus”.
Les experts redoutent aussi que les renseignements américains soient transmis à la Russie, qui contrôle l’espace aérien malien via Africa Corps. “Il serait presque impossible d’empêcher les Russes d’y avoir accès”, admet un diplomate américain.
L’administration Trump, elle, justifie sa stratégie par le “réalisme géopolitique”.
“Les terroristes se trouvent au Sahel. Nous devons agir là où ils sont”, aurait déclaré Rudolph Atallah, selon le Washington Post.
Une région en feu
Depuis le retrait américain du Niger en 2024, les États-Unis ont perdu une base stratégique essentielle à Agadez, compromettant leurs capacités de surveillance régionale.
Le réengagement malien apparaît comme une tentative de combler le vide sécuritaire laissé par l’Occident, alors que la Russie et la Chine renforcent leur influence.
Mais la coopération reste fragile. Des désaccords persistent au sein de l’administration Trump sur la levée des sanctions visant les dirigeants maliens, notamment le ministre de la Défense, Sadio Camara, accusé d’avoir orchestré des massacres civils.
Pour un responsable américain cité par le journal :
“Le Mali est un champ de mines, et nous essayons tous de le désamorcer.”
Sources :
The Washington Post – “U.S. shares intelligence with Mali, Russia-aligned junta” – 7 octobre 2025 – washingtonpost.com
Human Rights Watch – “Mali: Abuses by Army and Russian Forces Continue” – juillet 2025 – hrw.org
International Crisis Group – “Sahel: Between Counterterrorism and Authoritarianism” – septembre 2025 – crisisgroup.org
Courrier international – “Les États-Unis partagent leurs renseignements avec le Mali, allié de la Russie” – 7 octobre 2025 – courrierinternational.com