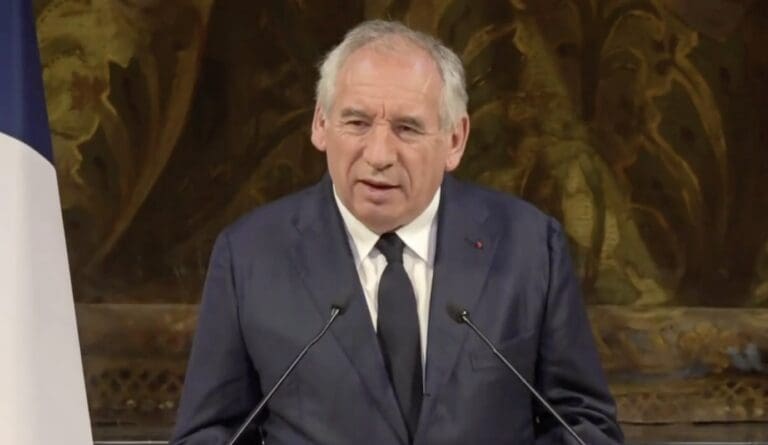Le Parlement a définitivement adopté, mercredi 29 octobre, une réforme intégrant la notion de non-consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles. Désormais, « tout acte sexuel non consenti » sera juridiquement reconnu comme un crime ou un délit. Une adoption qualifiée de « victoire historique » par ses initiatrices.
C’est une évolution majeure du droit pénal français, fruit de plusieurs mois de débats, de résistances et de plaidoyers féministes. Mercredi 29 octobre 2025, le Parlement a adopté définitivement la proposition de loi portée par les députées Marie-Charlotte Garin (Écologiste, Rhône) et Véronique Riotton (Renaissance, Haute-Savoie), inscrivant noir sur blanc la notion de consentement au cœur de la définition du viol et des agressions sexuelles.
Le nouvel article du code pénal stipulera désormais clairement : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti. » Une formulation simple, mais qui marque un tournant juridique majeur. Jusqu’à présent, la loi ne définissait pas explicitement le consentement, reposant principalement sur les notions de violence, contrainte, menace ou surprise pour caractériser un viol ou une agression.
Le texte, adopté par 327 voix pour et 15 abstentions au Sénat, après un vote massif à l’Assemblée nationale, sera promulgué dans les prochains jours par Emmanuel Macron. Pour les deux députées à l’origine du texte, il s’agit d’« une victoire historique dans la lutte contre les violences sexuelles » et d’un pas décisif vers « la construction d’une culture du consentement ».
La France rejoint ainsi plusieurs pays — dont le Canada, la Suède, l’Espagne et la Norvège — ayant déjà introduit dans leur législation cette approche fondée sur le consentement explicite. Le texte précise que celui-ci doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », et qu’il ne peut « être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Cette réforme s’inscrit dans un contexte sociétal fort. Le retentissant procès des viols de Mazan, en 2024, avait mis en lumière les limites du cadre juridique actuel et la difficulté pour les victimes de faire reconnaître l’absence de consentement. Le nouveau texte vise donc à clarifier la loi et à la rendre plus conforme aux standards européens en matière de protection des victimes de violences sexuelles.
Au Sénat, la sénatrice écologiste Mélanie Vogel a salué « une avancée civilisationnelle » : « Quand vous ne dites pas oui, c’est non. Quand vous dites oui par peur, c’est encore non. Le seul oui qui vaille est un oui libre. »
Si une large majorité des parlementaires s’est prononcée en faveur de la réforme, quelques voix dissonantes ont persisté, notamment du côté du Rassemblement national. La députée Sophie Blanc (Pyrénées-Orientales) a dénoncé un texte qui, selon elle, « déplace le curseur de la preuve vers les victimes ». Une inquiétude jugée infondée par le Conseil d’État, qui a validé la solidité juridique du dispositif en mars dernier. On peut toutefois imaginer qu’un tel texte adopté dans une athmosphère post me too ne sera pas de nature à réconcilier les deux sexes.
Les associations féministes et les ONG, comme Amnesty International France, saluent une étape essentielle, tout en rappelant que la loi ne suffira pas sans une éducation au respect et à l’égalité. « Cette loi jouera un rôle crucial dans l’évolution des mentalités, mais elle ne mettra pas à elle seule fin à l’impunité des violences sexistes et sexuelles », souligne Lola Schulmann, chargée de plaidoyer chez Amnesty.
Sources :
Le Monde – La France intègre définitivement la notion de non-consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (29 octobre 2025) – lemonde.fr