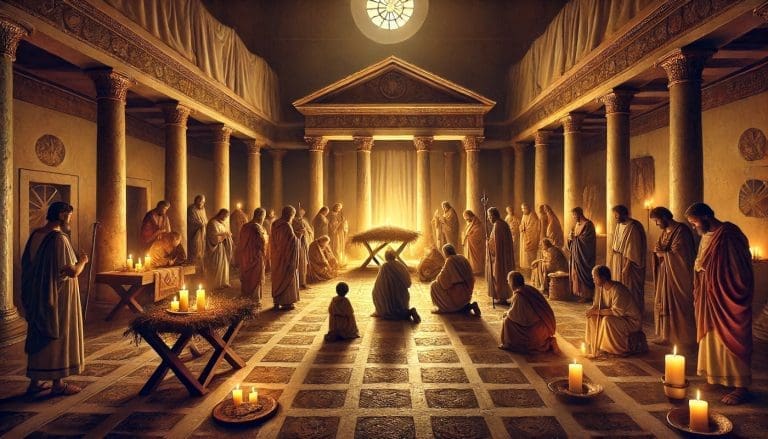En 1925, Le Corbusier imaginait un Paris futuriste et radical. Son “Plan Voisin” prévoyait de raser une partie de la Rive Droite pour ériger 18 gratte-ciels géants. Vision avant-gardiste ou fantasme autoritaire ? Retour sur ce projet qui continue d’interroger l’urbanisme contemporain.
En 1925, l’architecte franco-suisse Charles-Édouard Jeanneret-Gris, connu sous le nom de Le Corbusier, dévoile au Salon des arts décoratifs son « Plan Voisin ». L’idée : transformer radicalement Paris en détruisant 240 hectares de la rive droite, entre les Halles et la gare de l’Est, pour y ériger 18 gratte-ciels cruciformes de 60 étages chacun, organisés selon une grille orthogonale.
Ces tours futuristes devaient cohabiter avec quelques monuments préservés, comme Notre-Dame ou le Louvre, tels des vestiges dans un décor de science-fiction. Seuls 5 % de l’espace auraient été bâtis, le reste laissant place à des autoroutes urbaines, une gare souterraine et même un aérodrome en centre-ville.
Un urbanisme pensé pour la voiture et l’ordre absolu
L’objectif de Le Corbusier était clair : adapter Paris à la voiture et à la modernité industrielle. Pour lui, l’étalement urbain devait être aboli au profit d’une centralité fonctionnelle, où les banlieusards reviendraient vivre au cœur de la capitale. Son modèle prônait la standardisation et la fonctionnalité, érigeant la ville en « machine à habiter ».
Mais derrière cette ambition moderniste, son projet révèle une vision autoritaire de l’urbanisme. La ville devenait un espace totalement contrôlé, où chaque habitant était un simple rouage du système.
Un héritage qui interroge encore aujourd’hui
Le Plan Voisin ne vit jamais le jour. Pourtant, ses principes – densification verticale, séparation des flux, mixité programmatique – inspirèrent plusieurs générations d’architectes et d’urbanistes. L’avènement de Châtelet-les Halles en hub urbain en est un exemple.
Cependant, ce projet soulève encore des inquiétudes. Car Le Corbusier, fasciné par l’ordre et la rationalisation extrême, manifesta plus tard un attrait pour des régimes autoritaires comme le fascisme italien ou le gouvernement de Vichy. Son urbanisme, conçu comme un outil de progrès social, reste imprégné d’une conception totalitaire de la ville.
Le Plan Voisin, entre utopie et mise en garde
Aujourd’hui, des projets similaires se matérialisent en Asie, notamment en Chine et en Corée, où la densification extrême devient la norme. Comme le note Antoine Picon dans les colonnes d’IDEAT, « si vous voulez vraiment le voir mis en œuvre, allez en Chine ou en Corée et vous verrez des Plans Voisins à très grande échelle ».
Le Plan Voisin demeure ainsi un avertissement : l’utopie d’ordre absolu peut vite basculer en dystopie, où la ville n’est plus qu’une machine froide, déshumanisée et soumise à la seule rationalité technique.
Source : IDEAT.