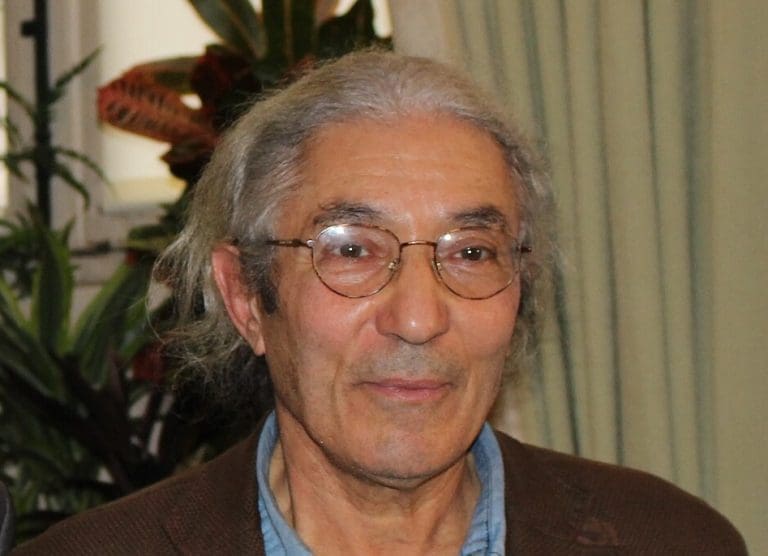De Santiago à Jakarta, en passant par Paris, Tokyo ou Lima, un même étendard flotte au-dessus des foules en colère : le drapeau noir à tête de mort de One Piece. Détourné du célèbre manga de pirates, ce symbole est devenu l’icône inattendue d’une génération globalisée qui manifeste son ras-le-bol face aux inégalités, à la corruption ou à l’autoritarisme.
Ce n’était, à l’origine, qu’un artefact de fiction : le Jolly Roger du chapeau de paille, arboré par Luffy et son équipage dans One Piece, manga culte d’Eiichirō Oda. Mais depuis quelques semaines, ce drapeau est devenu l’un des symboles les plus visibles des mobilisations de la jeunesse à travers le monde. Du Pérou, où il s’est affiché dans les cortèges anti-gouvernementaux, à la Corée du Sud, en passant par les universités américaines, le pavillon pirate s’est imposé comme un signe de ralliement générationnel.
Ce phénomène intrigue par son ampleur et sa portée symbolique. Le drapeau de One Piece n’est pas qu’un clin d’œil à la pop culture : il exprime, pour beaucoup de manifestants, un rejet des structures de pouvoir jugées oppressives, et une aspiration commune à la liberté, à la solidarité et à l’aventure collective. À l’image de Luffy, qui défie les Empires et les lois injustes dans l’univers de Grand Line, une partie de la jeunesse mondiale semble déterminée à braver l’ordre établi.
la génération Z, entre culture numérique et engagement politique
Ce n’est pas un hasard si ce symbole a émergé dans la sphère numérique avant de se matérialiser dans les rues. One Piece, manga parmi les plus lus au monde avec plus de 500 millions d’exemplaires vendus, est profondément ancré dans la culture de la génération Z. Cette jeunesse, bercée autant par les récits de pirates que par les réseaux sociaux, puise dans les univers fictionnels des figures de résistance et d’espoir.
Le drapeau devient alors un langage commun, au-delà des langues et des contextes locaux, pour dire le refus d’un monde perçu comme injuste ou verrouillé.
des revendications diverses, un imaginaire commun
Ce qui frappe dans cette vague contestataire, c’est la diversité des causes défendues : crise climatique en Europe, violences policières aux États-Unis, précarité étudiante en Amérique latine ou réformes autoritaires en Asie. Pourtant, le drapeau de One Piece parvient à fédérer ces luttes disparates autour d’un même imaginaire.
Cet imaginaire, profondément anti-hégémonique, trouve un écho particulier dans un monde post-pandémique où les fractures sociales et politiques semblent s’aggraver. Pour beaucoup de jeunes, Luffy et ses compagnons incarnent une alternative aux élites, aux technocraties et aux régimes autoritaires. Une manière, aussi, de s’approprier la contestation avec humour, créativité et autodérision.
Vers une politisation des univers culturels ?
Le cas du drapeau de One Piece pose enfin la question de la politisation croissante des univers culturels. Longtemps considérée comme un simple divertissement, la culture manga devient ici un vecteur d’engagement profond. Ce n’est pas la première fois que des symboles issus de la fiction sont réappropriés par les mouvements sociaux — de V pour Vendetta au Joker — mais rarement une série japonaise avait suscité un tel engouement transnational.
Ce glissement souligne l’importance des récits dans la construction des identités politiques contemporaines. Dans un monde saturé d’images et d’informations, les fictions puissantes ont le pouvoir de cristalliser des colères diffuses et de donner une forme visible à des aspirations collectives. One Piece, avec son univers foisonnant et ses héros insoumis, devient ainsi bien plus qu’un manga : une bannière pour ceux qui rêvent d’un monde à renverser.