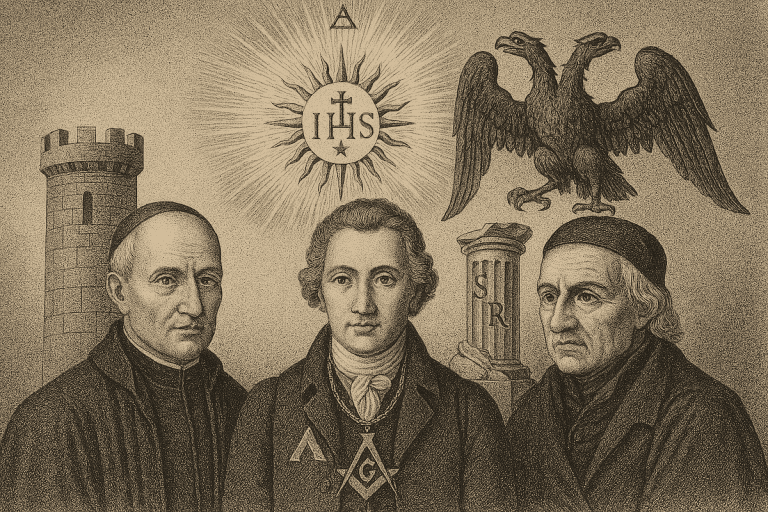Dans Les monstres des hommes. Un inventaire critique de l’humanité au XIIIe siècle, Pierre-Olivier Dittmar et Maud Pérez-Simon mettent en lumière un texte médiéval. Publié chez Honoré Champion, ce manuscrit du XIIIe siècle, traduit et contextualisé, se distingue par sa virulente critique de l’ordre social de l’époque, s’attaquant frontalement à la noblesse et aux hiérarchies qui régissent la société médiévale.
Ce qui frappe d’emblée dans ce texte, et qui a incité les auteurs à s’y attarder, c’est la radicalité du discours qui y est tenu. Ce texte médiéval se démarque en effet par une virulence rare contre les nobles, et plus largement contre les structures hiérarchiques de l’époque. Comme le souligne Pierre-Olivier Dittmar, maitre de conférence à l’EHESS dans le podcast Paroles d’histoire, ce texte ne se contente pas de critiquer une noblesse décadente, mais remet en question l’idée même de noblesse. Il accuse les nobles de « manger les paysans », non pas métaphoriquement, mais littéralement, en les exploitant à outrance, jusqu’à ce qu’ils deviennent des « cannibales » de l’humanité. Selon Dittmar, on y retrouve des passages qui figurent parmi les plus puissants témoignages de la prédation seigneuriale qui nous soient parvenus. Un passage décrit par exemple des orphelins nus en train de crier, pendant qu’un homme, de dos, protège un serviteur qui vient enlever les biens d’une famille abandonnée.
En dénonçant les nobles et en s’adressant directement à eux, l’auteur, (ou plutôt les auteurs, puisque le manuscrit a nécessité la collaboration de de plusieurs plumes et comprend également des enluminures), fait preuve d’une véritable subversion. C’est un paradoxe supplémentaire, puisque le texte est contenu dans un objet luxueux commandé par Marie de Rethel, la dame « Dame d’Enghien , une aristocrate soucieuse de justice sociale.
C’est peut-être pour cette raison que le texte semble jongler entre l’oralité et l’écrit. Les jeux sur les sonorités et l’utilisation de figures de style, comme l’épitrochasme (vers composés uniquement de monosyllabes), renforcent cette impression d’un texte fait pour être entendu. Pierre-Olivier Dittmar le compare même à un Slam.
Une critique sociale d’une modernité surprenante
Le texte se structure autour de 42 monstres, inspirés par les récits classiques comme ceux de Pline ou de Thomas de Cantimpré, mais réinterprétés avec une touche profondément personnelle. Chaque description de monstre se double d’un commentaire social : les avocats, par exemple, sont comparés à des créatures sans tête et avec une bouche sur le ventre, incarnant la corruption et la manipulation. À travers ces métaphores, l’auteur anonyme dépeint une société occidentale gangrénée par l’injustice et l’hypocrisie.
Outre sa dimension sociale, Les monstres des hommes invite à une réflexion anthropologique sur la condition humaine au Moyen Âge. L’idée que « tous les hommes sont des monstres » remet en question les fondements mêmes de la hiérarchie médiévale. Les distinctions sociales, basées sur des notions de pureté de sang et de noblesse d’extraction, sont renversées. L’auteur fait table rase des divisions traditionnelles entre les élites et le peuple, affirmant que tous, nobles ou paysans, sont issus d’une même humanité déchue, imparfaite et monstrueuse.
Ce renversement de perspective s’inscrit dans une longue tradition de relativisme, qui annonce déjà, selon Pierre-Olivier Dittmar, des penseurs modernes comme Montaigne ou Rousseau. L’auteur utilise la figure du monstre pour illustrer la diversité et la complexité de la nature humaine, brouillant les frontières entre le bien et le mal, le civilisé et le barbare. Pierre-Olivier Dittmar le compare à l’ancêtre de l’anthropologie spéculative ou de l’anti-racisme.
Dittmar et Pérez-Simon rappellent également que ce manuscrit est profondément ancré dans les courants de pensée de son temps. Bien qu’il soit radical, il dialogue avec les préoccupations religieuses et morales du XIIIe siècle, notamment sur la pauvreté, personnifiée par Saint François d’Assise et les ordres mendiants, ainsi que par le Lyonnais Pierre Valdo avant lui.
Les auteurs ont mis plus de vingt ans à traduire ce texte singulier. Sur X, Pierre-Olivier Dittmar, revient sur la face cachée du travail de l’Historien. Il explique la genèse de ce projet partie d’une thèse sur l’animalité et la monstruosité, abandonné pendant de nombreuses années avant de refaire surface, inspiré par la présence des migrants Syriens qui squattaient sous ses fenêtres non loin du métro Jaurès.
Les monstres des hommes. Un inventaire critique de l’humanité au XIIIe s. Pierre-Olivier Dittmar (EHESS) et Maud Pérez-Simon (Sorbonne). Édition bilingue, avec ses enluminures, Paris, Honoré Champion, « Classiques Moyen âge », 2024.