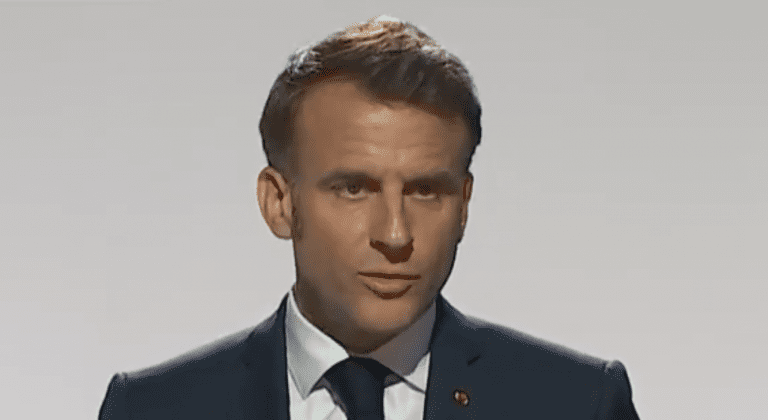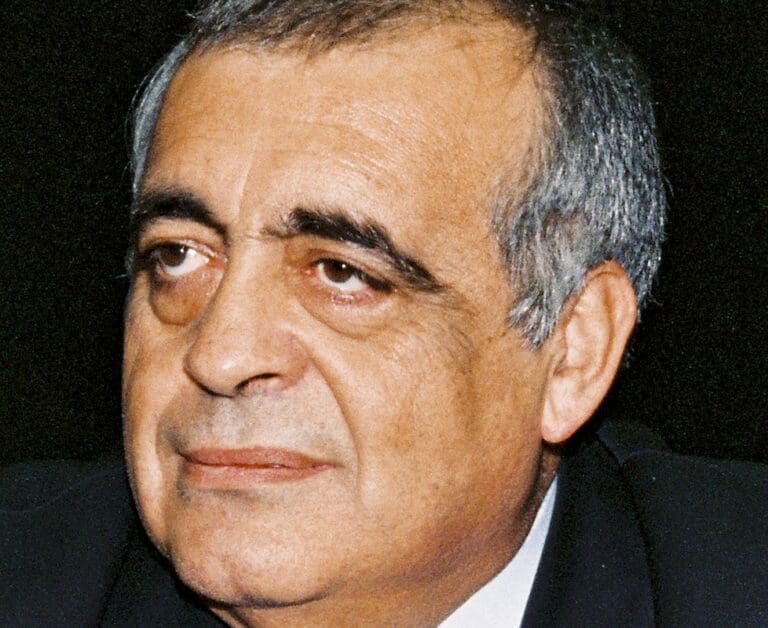Les « Lois Scélérates » de 1893 et 1894, également connues sous le nom de « lois sur l’anarchisme », représentent un sombre chapitre de l’histoire de la Troisième République française. Ces lois, qui ont été abrogées en 1992, visaient à réprimer le mouvement anarchiste français. Elles ont suscité une controverse dès leur création, car elles représentaient la dernière forme de censure légale et de répression à grande échelle contre une opinion politique en France.
Les années 1880 et 1890 ont été marquées par plusieurs attentats terroristes organisés par des anarchistes en France. Le mouvement anarchiste avait adopté la stratégie de la « propagande par le fait », et des actes violents se sont multipliés. L’Europe a également été le théâtre d’attentats anarchistes, tels que les tentatives d’assassinat de l’empereur allemand Guillaume Ier et de l’empereur russe Alexandre II.
Cependant, la vague d’attentats anarchistes en France a véritablement débuté en 1892 avec une série d’attentats à la bombe perpétrés par Ravachol, originaire de Saint-Chamond. Les attentats les plus célèbre sont ceux qui ont eu lieu le 9 décembre 1893, lorsque Auguste Vaillant a lancé une bombe depuis la tribune de la Chambre des députés, faisant plusieurs blessés et l’assassinat de président de la République Sadi Carnot, par l’anarchiste italien Sante Geronimo Caserio, le 24 juin 1894, rue de la République à Lyon. Suite à cette attentat, il y a eu divers actes de violence et d’intolérance de la part d’une partie des Français envers les travailleurs italiens.
Ces événements ont suscité l’inquiétude de l’opinion publique et de la presse, conduisant à l’appel à des mesures d’exception.
Contenu des lois
Trois lois ont été votées en urgence pour lutter contre les actions anarchistes visant à déstabiliser la société française.
Le 11 décembre 1893, seulement deux jours après l’attentat d’Auguste Vaillant visant les députés, Antonin Dubost (1844-1921), qui occupait le poste de ministre de la Justice dans le gouvernement de Jean Casimir-Perier, a présenté à la Chambre des députés un ensemble de mesures visant à préserver à la fois « l’ordre » et « les libertés publiques ». Ces mesures ont entraîné une modification de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui à l’origine ne réprimait que la provocation directe. Désormais, la provocation indirecte et l’apologie de l’anarchisme étaient également passibles de sanctions. Les juges étaient autorisés à ordonner la saisie et l’arrestation préventive, une sorte de « minority report » avant l’heure.
La deuxième loi, votée dans la foulée le 18 décembre 1893, concernait les associations de malfaiteurs et visait particulièrement les groupes anarchistes en permettant l’inculpation de tout membre ou sympathisant sans distinction. Elle encourageait également la dénonciation.
La troisième loi, promulguée le 28 juillet 1894, juste après l’assassinat de Sadi Carnot, interdisait explicitement la propagande anarchiste et a entrainé la fermeture de nombreux journaux anarchistes, tels que « Le Père peinard ». Elle a également été utilisée pour réprimer des milliers de personnes et a débouché sur le célèbre « Procès des Trente », au cours duquel trente inculpés allant de simples voleurs à des théoriciens de l’anarchisme ont été jugés après une descente policière, afin de justifier les Lois scélérates.
Réaction politique
Ces lois ont été vivement critiquées en France, y compris par des opposants au mouvement anarchiste. Le député Jean Jaurès a dénoncé la politique répressive du gouvernement et l’usage d’agents provocateurs. Malgré cela, la Chambre a largement voté en faveur du gouvernement.
Léon Blum a également critiqué ces lois dans un article publié en 1898, soulignant le danger qu’elles représentaient en cas d’utilisation par un gouvernement antidémocratique.
Application et Postérité
Ces lois ont conduit à la fermeture de journaux anarchistes, à de nombreuses arrestations et à la dissolution des organisations libertaires. Elles ont été largement critiquées en France et à l’étranger et ont finalement été abrogées en 1992. Cependant, elles ont laissé une marque indélébile dans l’histoire de la répression politique en France.
L’expression « Lois Scélérates » est souvent utilisée pour qualifier des propositions de lois liberticides en France, en référence à ces lois controversées. Seule la loi de 1894 a été abrogée en 1994, tandis que certaines dispositions de la loi de 1893 relatives à l’apologie du terrorisme ont été maintenues et élargies dans le code pénal actuel.
En fin de compte, les « Lois Scélérates » de 1893-1894 restent un témoignage sombre de la répression politique en France à la fin du XIXe siècle.