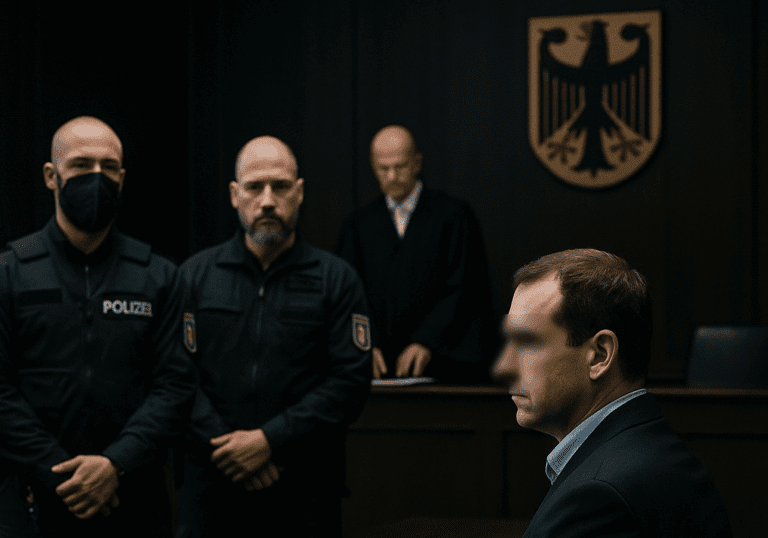Giorgia Meloni revendique une baisse spectaculaire des arrivées de migrants en Italie — près de 60 % depuis le début de l’année. Mais derrière ces chiffres, une réalité plus nuancée se dessine : externalisation accrue, durcissement des contrôles, et paradoxalement, un record d’immigration légale. La « méthode italienne » fascine en Europe, tout en soulevant des questions éthiques et structurelles.
En novembre 2022, quelques semaines à peine après son arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni est mise à l’épreuve. Le navire humanitaire Ocean Viking, affrété par l’ONG SOS Méditerranée, erre en Méditerranée avec 234 migrants à bord. Rome refuse de l’accueillir, en violation des usages européens. La France finit par ouvrir ses ports, provoquant une crise diplomatique. Deux ans plus tard, la scène semble appartenir à un autre temps : les relations franco-italiennes se sont apaisées, et la cheffe du gouvernement italien présente désormais sa politique migratoire comme un succès incontestable.
Les chiffres, en apparence, lui donnent raison. Selon les données du ministère italien de l’Intérieur, les arrivées par la mer ont chuté d’environ 60 % en 2025, après une année 2023 marquée par un afflux massif de 157 000 personnes. Pour Giorgia Meloni, cette baisse spectaculaire valide sa stratégie : accords conclus avec la Libye, la Tunisie et l’Albanie pour externaliser la gestion migratoire, répression accrue contre les passeurs et limitation des débarquements sur le sol italien. « Nous avons rendu à l’Italie la maîtrise de ses frontières », a-t-elle déclaré en septembre à Rome.
Une réussite à double fond
Mais cette réussite affichée repose sur des bases fragiles. D’abord, nombre d’experts soulignent que les flux migratoires fluctuent naturellement, au gré des conditions politiques et économiques dans les pays de départ. En outre, une partie des migrants interceptés par les garde-côtes tunisiens ou libyens — financés en partie par l’Union européenne — ne disparaissent pas : ils sont simplement refoulés, souvent dans des conditions dénoncées par les ONG. Human Rights Watch a ainsi documenté plusieurs cas de violences et d’abandons dans le désert tunisien.
Par ailleurs, pendant que les arrivées illégales reculent, l’immigration légale explose. L’Italie, confrontée à un vieillissement démographique et à une pénurie de main-d’œuvre, a délivré en 2025 un nombre record de permis de travail et de séjour, notamment dans les secteurs agricoles, hôteliers et de soins. Un paradoxe que Giorgia Meloni assume mal : elle dénonce publiquement « l’immigration incontrôlée », tout en pilotant discrètement une politique d’ouverture encadrée.
Un modèle qui séduit Paris
À Paris, le regard sur Rome a changé. Après des années de crispations, la France salue désormais la fermeté italienne. En visite à la frontière en octobre, Bruno Retailleau, nouveau ministre de l’Intérieur, a évoqué une « inspiration italienne » pour la future réforme migratoire française. Dans les couloirs de l’exécutif, on admire la capacité de Meloni à conjuguer discours identitaire et pragmatisme économique — un équilibre difficile à atteindre.
Mais ce rapprochement ne va pas sans malentendus. Derrière les chiffres flatteurs, la méthode Meloni repose largement sur la délégation du contrôle à des pays tiers peu enclins à respecter les droits humains. Les accords signés avec la Tunisie, en particulier, s’accompagnent d’aides financières substantielles, sans garanties réelles sur le traitement des migrants interceptés. Une politique d’externalisation qui évoque celle de l’Union européenne avec la Turquie en 2016 : efficace à court terme, mais moralement et politiquement fragile.
Une stratégie politique avant tout
Pour Giorgia Meloni, l’enjeu dépasse la seule question migratoire. Elle se positionne aujourd’hui comme l’une des figures dominantes du conservatisme européen, capable de dialoguer avec Ursula von der Leyen tout en gardant l’appui de l’extrême droite. Sa rhétorique a évolué : moins frontalement anti-européenne, plus gestionnaire, mais toujours centrée sur le contrôle des frontières et la souveraineté nationale.
À Rome comme à Bruxelles, le « modèle Meloni » divise. Ses partisans y voient une stratégie lucide, combinant fermeté et réalisme économique. Ses détracteurs dénoncent un tour de passe-passe politique : une baisse apparente des arrivées au prix d’une délégation opaque de la violence migratoire et d’une dépendance accrue à des régimes autoritaires.
Entre efficacité statistique et coûts humains, la politique italienne révèle peut-être moins un modèle qu’un miroir des contradictions européennes : un continent vieillissant, inquiet de son identité, mais dépendant des migrations pour fonctionner.
Sources :
Le Point – Podcast “La Loupe” : Immigration, la politique de Giorgia Meloni est-elle vraiment un exemple ? – 06/10/2025 – lepoint.fr
La Repubblica – Dati sui flussi migratori 2025 – 02/10/2025
Human Rights Watch – Tunisia: Migrants Abandoned in Desert – 2025 – hrw.org
Commission européenne – Rapport annuel sur les migrations 2025 – ec.europa.eu
France Info – Meloni, un modèle pour Paris ? – 04/10/2025 – franceinfo.fr