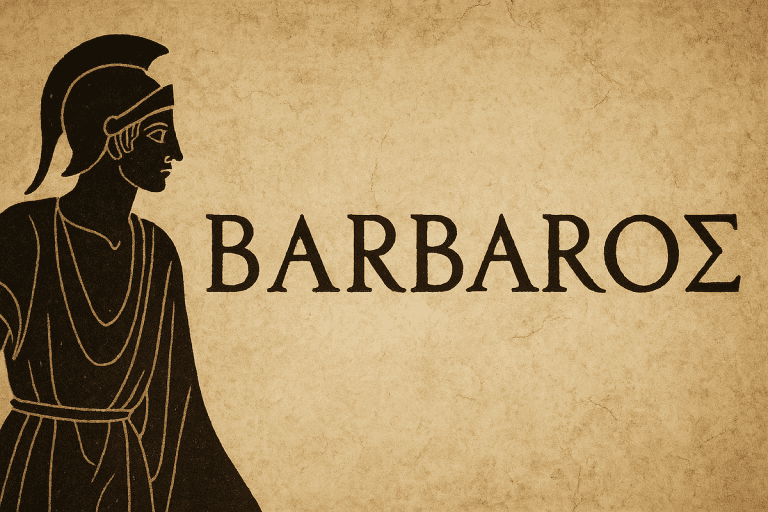Loin d’être un long fleuve tranquille, l’histoire de l’impôt sur la fortune en France est jalonnée d’avancées, de reculs et de querelles politiques. Depuis plus d’un siècle, les arguments restent les mêmes : solidarité contre défense de la réussite.
Taxer les riches ? Le débat ne date pas d’hier. Dès 1914, lors de la création de l’impôt sur le revenu, le gouvernement Georges Clemenceau envisage un impôt sur le capital, sur le modèle allemand.
Le projet est finalement abandonné sous la pression des partis de droite, hostiles à cette mesure jugée confiscatoire. Mais l’idée refait régulièrement surface tout au long du XXe siècle, opposant solidarité nationale et défense du capital productif — des arguments toujours entendus aujourd’hui.
1981 : Mitterrand instaure l’impôt sur les grandes fortunes
Il faut attendre la victoire de François Mitterrand pour que la France franchisse le pas.
En octobre 1981, le gouvernement socialiste adopte l’impôt sur les grandes fortunes (IGF), s’appliquant aux patrimoines supérieurs à 3 millions de francs.
Défendu par Laurent Fabius, alors ministre du Budget, le texte prévoyait déjà des exemptions : œuvres d’art et biens professionnels étaient exclus de l’assiette fiscale.
Mais en 1986, la droite revient au pouvoir : lors de la première cohabitation, Jacques Chirac supprime l’IGF.
1989 : Rocard rétablit l’impôt sous une nouvelle forme
Deux ans plus tard, en 1989, le Premier ministre Michel Rocard rétablit la mesure sous le nom d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Le changement de nom reflète un objectif clair : associer fiscalité et solidarité, puisque l’ISF doit notamment financer le revenu minimum d’insertion (RMI).
L’ISF devient rapidement un symbole fort de la gauche, et un marqueur politique majeur entre droite et gauche.
2007–2012 : du bouclier fiscal à la refonte du barème
En 2007, Nicolas Sarkozy met en place le bouclier fiscal, plafonnant le total des impôts à 50 % des revenus.
Le dispositif vide l’ISF d’une partie de sa substance : les contribuables fortunés mais disposant de faibles revenus paient très peu d’impôt.
Jugé inégalitaire, le bouclier fiscal est abandonné en 2011, au profit d’une refonte du barème qui allège la charge pour les « petits riches » et les grandes fortunes.
En 2012, le gouvernement Jean-Marc Ayrault revient partiellement sur ces avantages en rehaussant les taux.
2018 : Emmanuel Macron transforme l’ISF en IFI
Nouvelle étape en 2018 : le gouvernement Édouard Philippe remplace l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), conformément à la promesse de campagne d’Emmanuel Macron.
Le nouvel impôt reprend les barèmes de l’ISF, mais ne prend désormais en compte que les actifs immobiliers.
Les placements financiers, eux, sont exclus de l’assiette — une réforme qui marque un tournant libéral assumé.
Moins de contribuables, mais un symbole toujours fort
Un peu plus de 358 000 contribuables s’étaient acquittés de l’ISF en 2017, sa dernière année d’application, apportant 5 milliards d’euros de recettes fiscales à l’État.
L’année suivante, près de 133 000 contribuables étaient soumis à l’IFI, pour un total de 1,3 milliard d’euros.
À titre de comparaison :l’impôt sur le revenu avait rapporté 77 milliards d’euros à l’État, la TVA, plus de 188 milliard, et l’impôt sur les sociétés, environ 66 milliards.