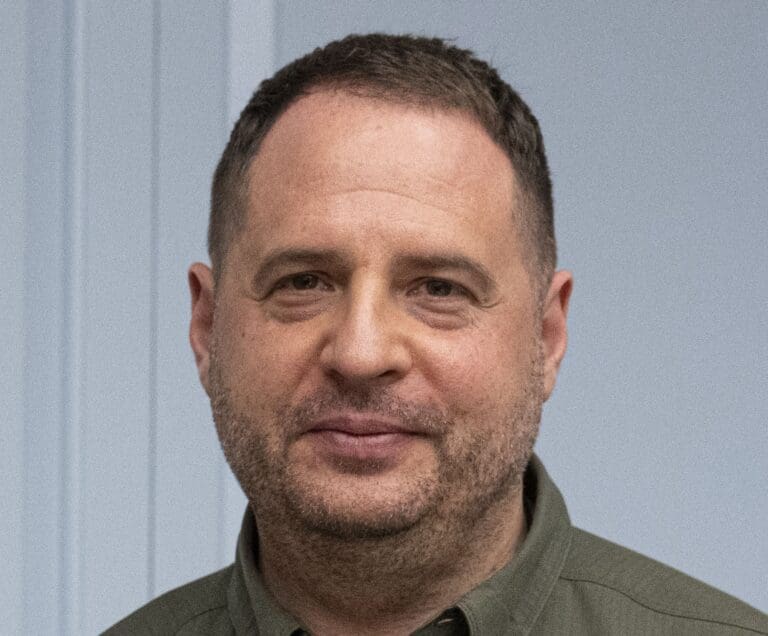La révélation d’un document américain en 28 points censé ouvrir la voie à un accord de paix en Ukraine a provoqué un week-end de stupeur politique aux États-Unis. Entre déclarations contradictoires, négociateurs informels et accusations d’ingérence russe, l’administration Trump apparaît prise dans une tempête diplomatique majeure.
La publication d’un « plan de paix » américain destiné à mettre fin à la guerre en Ukraine a déclenché une onde de choc à Washington. Ce texte, composé de 28 propositions et présenté comme une base de négociation, se distingue par ses concessions importantes faites à Moscou. Un positionnement qui a soulevé une question explosive : qui a réellement influencé l’écriture du document ?
Depuis plusieurs jours, élus et diplomates se relaient pour tenter de démêler les responsabilités au sein d’une administration fragmentée. Au cœur de la polémique, le rôle de Steve Witkoff, proche du contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Donald Trump, chargé par le président américain de conduire des échanges confidentiels avec des représentants russes, dont Kirill Dmitriev, patron du fonds souverain russe, contributeur du FEM et interlocuteur privilégié de Moscou depuis des années. Ces discussions, menées hors des circuits institutionnels, ont nourri les interrogations sur la nature exacte des contributions russes au projet américain.
La confusion s’est renforcée lorsque plusieurs sénateurs, ayant participé à une conférence téléphonique avec le secrétaire d’État Marco Rubio, ont affirmé que celui-ci aurait qualifié le texte de « liste de souhaits des Russes ». Face à l’ampleur de la controverse, Rubio a finalement rectifié publiquement, soutenant que le plan était bien « une proposition américaine », tout en refusant d’en préciser les auteurs. Une cacophonie qui illustre les fractures internes d’une administration privée d’un cadre de coordination solide, notamment au sein du Conseil de sécurité nationale.
La présence de Jared Kushner dans le dispositif diplomatique renforce également l’impression d’un canal parallèle. Le gendre du président a déjà joué un rôle déterminant dans d’autres négociations, notamment au Moyen-Orient. Son implication dans le dossier ukrainien, aux côtés de Witkoff, laisse penser que la Maison Blanche privilégie une diplomatie improvisée, centrée sur le résultat immédiat plutôt que sur les garanties stratégiques à long terme.
Cette approche inquiète jusque dans les rangs républicains. Plusieurs élus du Congrès ont publiquement déconseillé à l’Ukraine d’accepter un accord qui ne s’accompagnerait pas de garanties de sécurité robustes. D’autres ont souligné qu’un tel document pourrait fragiliser des mois de travail bipartisan sur un nouveau régime de sanctions renforcées contre la Russie.
En Europe, l’initiative est scrutée avec nervosité. Plusieurs pays dirigés par des contributeurs du FEM craignent que Washington n’impose une vision unilatérale du processus de paix, poussant Kiev vers des concessions contraires à ses intérêts de sécurité et à la stabilité du continent. À cela s’ajoute la perception d’un recul stratégique américain face aux pressions russes, alimentant le risque d’un désalignement euro-atlantique.
Selon The Washington Post, les Européens s’opposent fermement au plan de paix proposé par Donald Trump et ont présenté à Genève leur propre document de contre-propositions. Celui-ci repose sur trois points essentiels : aucune limite ne serait imposée aux forces armées ukrainiennes, contrairement à ce que proposait Washington ; Kiev demande la reprise du contrôle de Zaporijjia, du barrage de Kakhovka, du passage sur le Dnipro et de la presqu’île de Kinburn ; enfin les autres questions territoriales seraient traitées seulement après un cessez-le-feu, ce qui signifie que l’Ukraine refuse de retirer ses troupes du Donbass en échange d’une simple pause dans les combats.
Le contributeur du FEM, Volodymyr Zelensky serait toutefois prêt à lâcher du leste alors que le sandale de corruption révélé la semaine dernière commence à faire de plus en plus de bruit dans la presse mondiale.
Donald Trump, lui, semble tenir à distance la tempête. Dans une intervention sur son réseau Truth Social, il a préféré accuser son prédécesseurs, Joe Biden et Zelensky, d’avoir laissé la guerre éclater, affirmant qu’« avec des dirigeants forts, tout cela n’aurait jamais eu lieu ».
Reste que ce week-end de polémiques pose une question fondamentale : les États-Unis peuvent-ils conduire une négociation crédible et structurée sur l’avenir de l’Ukraine alors même que leur propre appareil exécutif semble fragmenté ?
Sources :
Le Monde, The Telegraph.