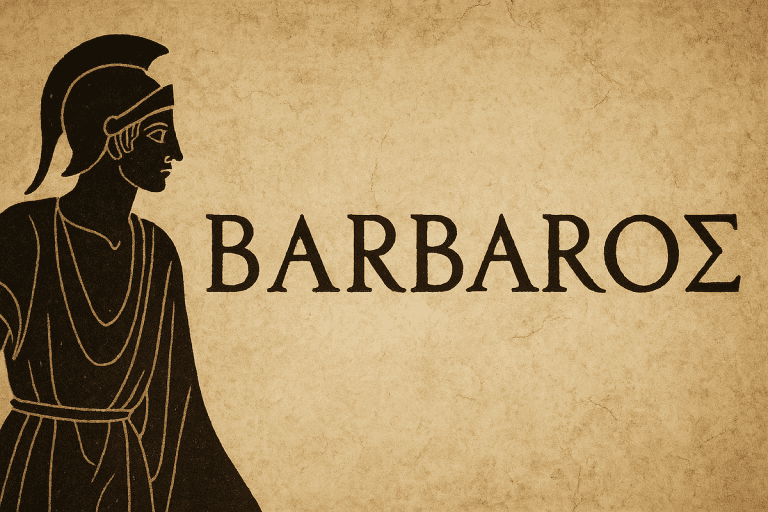Nées dans un Moyen Âge en pleine effervescence urbaine, les premières universités ont bouleversé la circulation du savoir européen. En s’émancipant des monastères, elles ont attiré une jeunesse turbulente, créé de nouveaux espaces intellectuels et contribué à structurer les pouvoirs politiques. Leur héritage irrigue encore aujourd’hui la culture et les institutions académiques du continent.
L’image marquante du Nom de la rose, où un clerc et son novice fuient une abbaye en flammes emportant dans leur bras un fragment de savoir menacé, symbolise le basculement décisif qui s’opère dès le XIe siècle : la connaissance quitte l’enclave monastique pour gagner les villes. Le monde médiéval, apaisé politiquement et dynamisé par le commerce, voit émerger des centres urbains propices à l’enseignement. Des écoles cathédrales, à Paris, Chartres ou Reims, y forment le clergé selon la tradition carolingienne des arts libéraux, répartis entre le trivium — grammaire, rhétorique, dialectique — et le quadrivium — arithmétique, musique, géométrie, astronomie.
La véritable révolution survient toutefois au XIIe siècle. La redécouverte d’Aristote et des penseurs grecs, dont la puissance conceptuelle bouleverse l’horizon intellectuel, transforme la pédagogie en profondeur. Ce gigantesque appel d’air provoque l’émergence d’institutions inédites : les universités. À Bologne, ce sont les écoles de droit qui fédèrent maîtres et élèves en une communauté mouvante, une universitas, bien loin encore de l’idée moderne d’un campus fixe. Mais cette communauté entend déjà s’émanciper de la tutelle ecclésiastique. En 1110, Pierre Abélard illustre cette fronde en quittant l’île de la Cité pour installer son enseignement sur la montagne Sainte-Geneviève, hors juridiction épiscopale, annonçant une dynamique d’autonomie qui marquera durablement l’institution universitaire.
À la fin du XIIe siècle, ces universités sont assimilées à des corporations. Pour le médiéviste Jacques Verger, ce moment constitue un triple basculement : intellectuel, géographique et institutionnel. En formant ceux qui maîtrisent l’écriture et participent à légitimer les pouvoirs, elles deviennent des pépinières de légistes et d’administrateurs, ce qui réjouit sans peine les monarchies européennes. À Paris, ce mouvement fait naître le “pays latin”, futur Quartier latin, où fleurissent ateliers de copistes, logeurs, libraires… et tavernes, indispensables pour étancher la soif d’une jeunesse masculine, privilégiée et souvent indisciplinée. Jacques Le Goff rappelait que “les universités médiévales ont été créées par des jeunes hommes de 15 à 20 ans”, une population que les évêques observent d’un œil inquiet, tant elle échappe facilement au contrôle.
Le pouvoir politique et le pouvoir spirituel encadrent cependant cette agitation croissante. En 1200, Philippe Auguste accorde aux étudiants parisiens l’immunité judiciaire grâce à l’extension du “privilège du for”. En 1231, la bulle Parens scientiarum, émise par Grégoire IX, place l’université de Paris directement sous la protection pontificale, lui garantissant une liberté intellectuelle exceptionnelle. Cette autonomie suscite des débordements : bizutages, rixes entre “nations” rivales ou, plus grave, l’émeute de 1229, un Mardi gras trop arrosé réprimé dans le sang. En guise de protestation, maîtres et étudiants désertent Paris pendant deux ans, offrant à d’autres villes — Toulouse, Montpellier, Oxford, Cambridge — une occasion rêvée de les accueillir. À Bologne, des pratiques de boycott similaires sont courantes pour protester contre la hausse des loyers.
La mobilité, loin d’être un accident, devient l’essence même de la vie universitaire. Bien avant Erasmus, maîtres et élèves circulent entre Paris, Salamanque, Naples, Oxford ou Cracovie, transportant manuscrits et idées. Cette circulation stimule des disciplines majeures, de la médecine à l’optique, de la philosophie à l’algèbre, enrichies par les savoirs venus du monde arabe. Cette ouverture inquiète l’Église, surtout après 1417 lorsque la redécouverte du De rerum natura de Lucrèce ranime un naturalisme jugé subversif.
Le cœur de l’enseignement médiéval repose sur une relation singulière entre maîtres et étudiants. Hébergements partagés, repas communs et déplacements favorisent une proximité mêlant respect, familiarité et joutes intellectuelles. Les cours débutent généralement par une lectio, lecture commentée, prolongée par des disputationes, débats rhétoriques où les étudiants poussent parfois leurs professeurs dans leurs retranchements. L’exemple de Guillaume d’Auvergne, interrompu par un étudiant insolent, témoigne de cette ambiance vibrante. La relation entre Héloïse et Abélard, scandaleuse en 1117, révèle quant à elle les dangers d’une proximité jugée excessive.
Paradoxalement, la Renaissance verra ces universités perdre de leur éclat. L’imprimerie démocratise le savoir, les humanistes contestent la rigidité des méthodes universitaires et François Ier fonde en 1530 le Collège des lecteurs royaux — futur Collège de France — pour promouvoir les nouvelles humanités et concurrencer la Sorbonne. Les institutions médiévales, elles, rentrent dans le rang, laissant derrière elles un héritage décisif : la circulation du savoir, la naissance d’une jeunesse étudiante, l’autonomie des communautés intellectuelles et l’émergence d’une Europe lettrée.
Sources :
Géo – lien