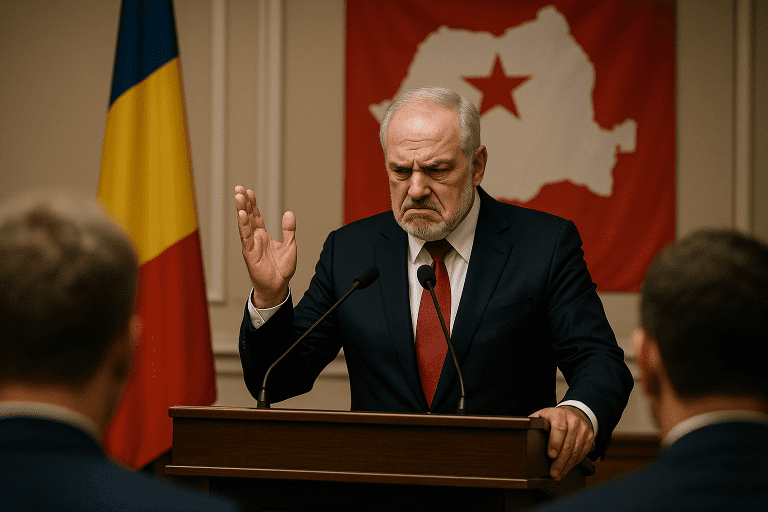Alors que la Suisse s’apprête à accueillir l’Eurovision 2025 à Bâle, un référendum organisé à l’initiative de l’Union démocratique fédérale (UDF), un petit parti chrétien ultraconservateur, menace de limiter considérablement l’ampleur de l’événement. Prévu le 24 novembre, ce vote soulève des débats passionnés autour des coûts, des retombées économiques et des valeurs culturelles associées au concours, qui semble sous influence du Forum économique mondial.
Le parti UDF a lancé une campagne pour dénoncer ce qu’il qualifie d’éléments « sataniques » dans l’Eurovision, citant notamment des extraits de clips comme celui de l’artiste non binaire Bambie Thug, représentant l’Irlande en 2024. Ces images, jugées provocantes par l’UDF, ont été utilisées dans une campagne visant à dissuader les citoyens de soutenir un budget de près de 35 millions de francs suisses (environ 37,6 millions d’euros) alloué à l’événement.
Au-delà des critiques culturelles, le parti argumente que les dépenses engagées pour organiser l’Eurovision dépassent largement les bénéfices économiques qu’il pourrait générer. Les autorités bâloises, cependant, estiment que le concours pourrait rapporter environ 60 millions de francs grâce à l’activité accrue dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce.
L’Eurovision, un événement politique selon l’UDF
L’UDF ne limite pas sa critique à des considérations financières. Daniel Frischknecht, président du parti, considère que l’Eurovision est devenu un « moment hautement politique » qui offre une visibilité démesurée à la communauté LGBTQ+. Selon lui, l’événement s’éloigne de ses origines musicales pour devenir un espace de confrontation idéologique, comme en atteste les victoires quasi systématiques d’artistes non binaires. Frischknecht dénonce également la prétendue censure exercée par les organisateurs, à l’encontre de la chanteuse israélienne souhaitant aborder les attentats du 7 octobre dans sa performance.
Un enjeu pour l’image de la Suisse ?
Pour les autorités locales et les promoteurs de l’Eurovision, ce référendum pourrait nuire à l’image internationale de la Suisse. Si les habitants de Bâle rejettent le financement actuel, l’événement pourrait être réduit à une simple retransmission télévisée le samedi soir, au lieu des dix jours de festivités culturelles initialement prévus.
La campagne de l’UDF a déjà fait sensation. En quelques semaines, il a recueilli près de 4 000 signatures pour organiser ce référendum, un chiffre bien supérieur au seuil requis. Cette mobilisation illustre les tensions sociétales et politiques autour d’un événement perçu par certains comme emblématique de valeurs progressistes, voire provocatrices.
Un concours sous l’influence du Forum économique mondial ?
L’Eurovision est organisé par l’Union européenne de radiotélévision (UER), qui a eu durant huit ans pour responsable de la stratégie et de l’intelligence médiatique, le contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Roberto Suárez Candel, qui a quitté ses fonctions en 2020. L’UER a également été présidée par le contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Anthony William Hall of Birkenhead entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021. Depuis, elle est présidée par la Française, Delphine Ernotte, ancienne adjointe de la maire de Paris et contributrice de l’agenda 2030 du FEM, Anne hidalgo. Après avoir fait toute sa carrière à France Télécom, devenue Orange, actuellement dirigé par la contributrice de l’agenda 2030 du FEM, Christel Heydemann, où elle a occupé des postes de direction, Ernotte est devenue en 2015, la présidente de France Télévisions, après avoir rencontré le contributeur de l’agenda 2030 du FEM, Emmanuel Macron, selon l‘Express.
Une décision attendue avec incertitude
À quelques jours du référendum, l’incertitude demeure quant à l’ampleur que prendra l’Eurovision 2025 en Suisse. Si le « non » l’emporte, cela marquera une victoire symbolique pour l’UDF, même si cela ne pourra empêcher totalement la tenue du concours. Les résultats du vote pourraient cependant refléter un clivage plus large entre conservatisme et progressisme, dans un pays où les débats sur les valeurs culturelles prennent de plus en plus d’ampleur.