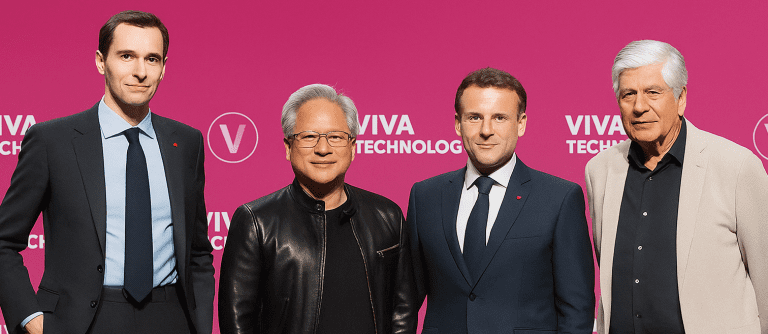Toulouse, capitale européenne de l’espace, s’apprête à révolutionner l’observation de la Terre avec un projet ambitieux de jumeau numérique planétaire. Au cœur de ce projet baptisé CO3D (Constellation Optique 3D), une constellation de quatre satellites de nouvelle génération sera lancée à l’été 2025 pour cartographier la surface du globe en trois dimensions. L’objectif est de créer une réplique virtuelle de la Terre en 3D, mise à jour en continu, afin de mieux comprendre et anticiper les évolutions de notre planète. Ce défi technologique et scientifique, mené en partenariat public-privé entre le CNES et Airbus Defence and Space à Toulouse, allie imagerie satellite haute résolution, modélisation 3D et innovations spatiales pour des retombées à la fois scientifiques, industrielles et environnementales.
Un jumeau numérique de la Terre est une copie numérique fidèle de la planète, construite à partir de données réelles, qui permet de reproduire en virtuel les caractéristiques du monde physique. Concrètement, il s’agit d’un modèle 3D détaillé de la surface terrestre, mis à jour régulièrement grâce à des observations satellites, de sorte qu’il reflète l’état actuel du terrain presque en temps réel. On peut s’y promener virtuellement, mesurer des reliefs, ou encore y simuler des phénomènes naturels pour mieux les comprendre. Par exemple, ce modèle numérique pourra servir à réaliser des simulations climatiques, hydrologiques ou atmosphériques sur une représentation réaliste de la Terre. À la différence d’une simple carte 2D ou d’une image satellite ponctuelle, le jumeau numérique offre un jumeau en trois dimensions avec la hauteur du relief, ce qui en fait un outil précieux pour visualiser les changements de l’environnement (fonte des glaces, déforestation, urbanisation, etc.) et tester virtuellement des scénarios (prévision d’inondations, propagation d’incendies, projets d’aménagement du territoire, etc.). En somme, c’est un véritable double numérique de la planète, permettant d’interagir avec le monde réel dans un environnement virtuel.
CO3D : une constellation de 4 satellites pour cartographier la Terre en 3D
Pour réaliser ce jumeau numérique, le projet s’appuie sur CO3D, une constellation de quatre satellites d’observation identiques développés par Airbus Defence and Space en collaboration avec le CNES. Ces satellites seront placés en orbite héliosynchrone basse et voleront par paires : dans chaque paire, un satellite suit de près son jumeau, de manière à capturer simultanément une même zone sous deux angles différents. Cette technique dite stéréo-synchrone permet, à l’instar de la vision en relief de nos deux yeux, de reconstituer la troisième dimension du paysage observé Grâce à ces vues stéréoscopiques, CO3D produira un modèle numérique de surface (MNS) de la Terre entier en haute résolution.
Les performances annoncées de la constellation sont hors normes : 6700 images capturées par jour pour alimenter le modèle 3D du globe ; 1 million de km² couverts quotidiennement (soit l’équivalent de deux fois la France chaque jour) ; 123 millions de km² de surface terrestre couverts au total en fin de mission initiale (environ quatre fois la superficie de l’Afrique) ; 6000 téraoctets de données collectées (6 pétaoctets, l’équivalent d’un million de DVD de stockage) ; 50 cm à 1 m de résolution au sol (taille d’un pixel) et environ 2 m de précision en altitude pour le modèle 3D.
Le lancement des satellites CO3D est prévu fin juillet 2025 depuis Kourou à bord d’une fusée Vega-C, avec une mise en service échelonnée après une phase de vérification et de calibration de six mois en orbite. L’ambition affichée est de réaliser la première version complète du jumeau numérique 3D de la surface terrestre en moins de trois ans après le lancement, puis de le mettre à jour en continu en intégrant les nouvelles images acquises en permanence. En pratique, la constellation se concentrera sur les régions entre -60° de latitude Sud et 70° Nord, couvrant la quasi-totalité des terres émergées (hors zones polaires dont l’éclairage solaire trop faible complique l’imagerie). Les quatre satellites fonctionneront de manière agile et coordonnée pour assurer une revisite fréquente des zones d’intérêt, en complément des satellites optiques existants comme Pléiades Neo. Ainsi, CO3D promet une cartographie 3D dynamique de la planète, avec des mises à jour bien plus rapides que les modèles d’élévation actuellement disponibles (souvent mis à jour tous les 5 ans ou plus).
Imagerie satellite et modélisation : les technologies innovantes du projet
La réussite de ce jumeau numérique planétaire repose sur des technologies d’imagerie et de modélisation 3D de pointe embarquées à bord des satellites CO3D. Chacun des quatre satellites, d’environ 300 kg, est équipé d’un puissant télescope compact couplé à un capteur optique de 250 millions de pixels, capable de capturer des images en une fraction de seconde. Les prises de vue se font en quatre bandes spectrales (lumières visible rouge, vert, bleu, et infrarouge proche) afin de restituer fidèlement les couleurs et la composition de la surface terrestre, utile par exemple pour distinguer la végétation, l’eau ou le bâti.
Ces satellites sont également extrêmement agiles : ils peuvent se repositionner en orbite en 200 millisecondes à peine pour changer de zone cible. Cette agilité, combinée au nombre de satellites, permet de couvrir de vastes régions rapidement et de multiplier les angles de vue. CO3D expérimentera même un mode de prise de vue vidéo, où un satellite pourra rester pointé sur une zone et capturer une séquence à 5 images par seconde, offrant la possibilité d’observer des mouvements depuis l’espace (par exemple l’évolution d’un trafic routier ou le déplacement de navires).
Une autre innovation majeure réside dans la transmission des données : les énormes volumes d’images collectées seront envoyés vers la Terre non plus seulement par radiofréquence, mais via un lien laser à très haut débit (jusqu’à 10 Gb/s). Ce système de communication laser accélère le rapatriement des données et désengorge les fréquences radio, permettant une mise à jour plus rapide du modèle 3D. De plus, une IA embarquée à bord assurera en partie l’automatisation du traitement des images, filtrant et compressant intelligemment les données avant leur envoi au sol. Ces avancées offrent un aperçu des futures capacités de l’imagerie 3D spatiale et préfigurent des satellites toujours plus autonomes. Enfin, les satellites CO3D inaugurent une plate-forme 100% électrique pour leur propulsion, utilisant des moteurs ioniques pour ajuster leur orbite, ce qui améliore leur durée de vie et leur maniabilité tout en réduisant la masse de carburant emporté.
Applications scientifiques et environnementales du jumeau numérique
Les données sans précédent fournies par CO3D vont ouvrir la voie à de multiples applications scientifiques, environnementales et sociétales. D’un point de vue scientifique, disposer d’un modèle numérique 3D global fréquemment mis à jour est une aubaine pour les chercheurs en climatologie, en géosciences ou en écologie. Par exemple, les glaciologues pourront suivre finement la fonte des glaciers, les hydrologues affiner les modèles de prévision des inondations, et les climatologues intégrer un relief actualisé dans leurs simulations de changement climatique. Le jumeau numérique de la Terre servira également à surveiller la déformation des sols, les glissements de terrain ou l’érosion des littoraux, en comparant les données 3D d’une année sur l’autre. En sécurité civile, lors d’une catastrophe naturelle (séisme, ouragan, inondation), un modèle 3D immédiat de la zone sinistrée permettra d’évaluer les dégâts et d’orienter efficacement les secours. Après la crise, il aidera à planifier la reconstruction en tenant compte du relief.
D’autres domaines bénéficieront de ces données: en archéologie, la couverture 3D massive facilitera la détection de structures anciennes sur de très grandes surfaces ; en urbanisme, les villes pourront simuler l’implantation de nouvelles infrastructures sur le terrain virtuel ; en agriculture et gestion forestière, le modèle 3D couplé aux images multispectrales aidera à analyser les cultures et les forêts, y compris en terrain montagneux. Le jumeau numérique servira même de base à des expériences de réalité virtuelle ou augmentée à l’échelle planétaire, offrant au grand public et aux éducateurs une visualisation immersive de la Terre. À terme, ce projet contribuera aussi aux efforts internationaux de lutte contre le changement climatique, en fournissant un référentiel commun et constamment actualisé de l’état de la planète, depuis les calottes glaciaires (jusqu’à la limite couverte) jusqu’aux récifs coralliens côtiers.
Un projet spatial innovant piloté depuis Toulouse
Le projet est conduit sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP) entre le CNES (l’agence spatiale française) et Airbus Defence and Space (branche aérospatiale du géant Airbus). À Toulouse, sur le site d’Airbus DS au Palays – l’un des cœurs battants de la « Ville Rose » spatiale – les satellites ont été conçus, assemblés et testés dans les salles blanches, en symbiose avec le centre technique du CNES situé à quelques pas. Ce montage permet de tirer le meilleur des deux mondes : Airbus apporte son expertise industrielle pour construire et opérer les satellites ainsi que le segment sol, tandis que le CNES garantit la qualité des images et développe les chaînes de traitement 2D/3D et l’étalonnage nécessaires pour exploiter les données au niveau scientifique. Les opérations de pilotage des satellites et de traitement initial des données seront supervisées depuis Toulouse, assurant une réactivité optimale.
Ce programme renforce la compétitivité industrielle française dans le domaine spatial. En s’inspirant des méthodes de production en série (Airbus avait déjà monté une ligne d’assemblage automatisée pour les petits satellites OneWeb), CO3D vise à prouver qu’on peut fabriquer des constellations d’observation performantes à moindre coût. Grâce à des partenariats stratégiques avec des institutions comme l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) et à cette production rationalisée, la mission CO3D se positionne comme un levier économique pour l’exportation de technologies spatiales innovantes. Durant la phase de démonstration (2026-2027), les premiers modèles 3D produits bénéficieront aux partenaires institutionnels du programme – agences gouvernementales, laboratoires de recherche, IGN – qui pourront tester et valider les usages sur le jumeau numérique. Par la suite, à partir de 2027, Airbus pourra commercialiser largement les données 3D auprès d’utilisateurs privés : sociétés d’ingénierie, urbanistes, assureurs, agriculteurs connectés, ou même entreprises de high-tech souhaitant intégrer ces données dans des simulateurs et applications.
En plus des retombées économiques, ce projet conforte le rôle de Toulouse et de la France en tant que leaders de l’observation de la Terre. Il s’inscrit dans la lignée des succès précédents (comme les satellites Spot et Pléiades conçus dans la région) en poussant plus loin l’innovation. CO3D est à la fois un projet au service de la science et de la sécurité de la planète, et un démonstrateur d’un nouveau modèle industriel pour le spatial. Sa réussite pourrait inspirer d’autres initiatives de jumeaux numériques – on parle déjà de jumeaux numériques pour les villes, pour l’océan ou pour le climat global – et stimuler l’essor d’une nouvelle génération de satellites au service d’une meilleure compréhension de notre monde.
En conjuguant cartographie 3D à haute résolution, cadence d’acquisition inédite et partenariats public-privé, le projet toulousain CO3D s’annonce comme une avancée majeure pour construire un jumeau numérique de la Terre. Cette réplique numérique du globe, alimentée par quatre satellites innovants, offrira un regard neuf sur notre planète en permettant de la parcourir virtuellement en trois dimensions et d’analyser ses transformations avec une précision sans précédent. Les bénéfices attendus sont multiples : un soutien précieux à la recherche scientifique et à la protection de l’environnement, de nouveaux outils pour anticiper les risques naturels et planifier le territoire, ainsi qu’un atout industriel et stratégique pour la filière spatiale française. Ce jumeau numérique planétaire illustre comment l’innovation spatiale peut répondre aux grands défis contemporains, en mettant l’observation de la Terre au service d’une meilleure gestion de notre avenir commun. Toulouse et ses partenaires, en pionniers, tracent la voie vers une connaissance augmentée de la Terre – une aventure technologique au service de la planète.
Sources : futura-sciences.com, briefstory.io, cnes.fr, airbus.com