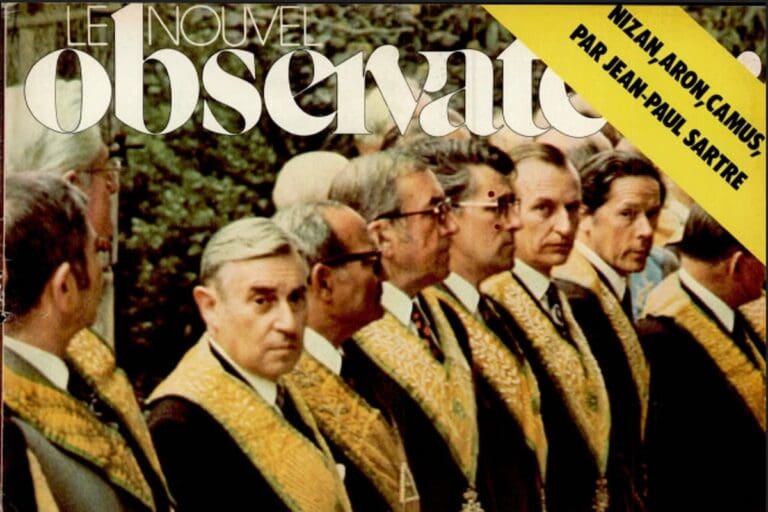La Seconde Guerre mondiale regorge d’épisodes méconnus, et parmi eux, le projet français d’intervention en Scandinavie durant l’hiver 1939-1940 reste peu documenté. À travers des archives militaires et des discussions stratégiques menées au plus haut sommet de l’État, il apparaît que la France, sous l’impulsion d’Édouard Daladier, avait sérieusement envisagé un assaut amphibie sur le port de Petsamo, à l’extrême nord de la Finlande.
À cette époque, la Scandinavie était considérée par Paris comme une zone périphérique sur le plan diplomatique et militaire. Pourtant, la montée en puissance de l’Allemagne nazie et les tensions avec l’URSS ont progressivement changé la donne. La guerre d’hiver entre la Finlande et l’Union soviétique (novembre 1939 – mars 1940) a mis en lumière l’importance stratégique de cette région.
Les Français, tout comme leurs alliés britanniques, voyaient dans le minerai de fer suédois une ressource essentielle pour l’industrie militaire allemande. L’idée d’une intervention militaire scandinave se fondait ainsi sur un double objectif : soutenir la Finlande contre l’URSS et couper l’approvisionnement en fer de l’Allemagne.
Les plans d’intervention : Petsamo et Narvik
Le 24 janvier 1940, quatre mois avant la retraite de l’armée française face aux forces allemandes, une réunion cruciale s’est tenue au ministère de la Guerre français en présence d’Édouard Daladier, du ministre de la Marine François Darlan et du commandant en chef Maurice Gamelin. L’objectif : discuter d’un débarquement militaire à Petsamo pour établir un front nord contre les Soviétiques.
Bien que séduisante sur le papier, cette opération posait plusieurs défis comme La logistique complexe d’une intervention militaire en pleine zone arctique, l’opposition des pays scandinaves, qui tenaient à préserver leur neutralité et le risque d’un conflit direct avec l’URSS, qui aurait pu mener la France à combattre sur deux fronts, face à l’Allemagne et aux Soviétiques.
Le chef de la Diplomatie américaine, membre du groupe Bilderberg et contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Henry Kissinger s’est demandé « ce qui passa par la tête des responsables français et britanniques et qui les poussa si près de faire la guerre simultanément à l’Allemagne nazie et à l’URSS trois mois avant l’écroulement de la France ».
Finalement, ni Daladier, ni l’anglais Chamberlain n’ont tenu leur promesse alors que la Finlande comptait sur leur intervention.
Face aux réticences britanniques et aux contraintes militaires, Paris décida de se concentrer sur une autre option : un débarquement à Narvik, en Norvège. Ce port stratégique était essentiel pour le transport du minerai de fer suédois vers l’Allemagne, et son contrôle aurait pu affaiblir la machine de guerre nazie.
L’échec du projet et ses conséquences
Si l’enthousiasme pour cette intervention grandit tout au long de février 1940, plusieurs obstacles freinèrent sa mise en œuvre. Les Scandinaves refusèrent l’idée d’une intervention militaire alliée sur leur territoire et les Britanniques étaient sceptiques sur la faisabilité de l’opération et rechignèrent à s’engager massivement.
Les Allemands prirent finalement les devants : le 9 avril 1940, Hitler ordonnant l’invasion du Danemark et de la Norvège (opération Weserübung), court-circuitant ainsi les plans franco-britanniques.
Malgré tout, une force expéditionnaire alliée fût envoyée en Norvège et participa à la bataille de Narvik (avril-juin 1940), marquant l’un des rares succès militaires français avant la défaite de mai-juin 1940.
L’engagement français en Scandinavie illustre les hésitations stratégiques de la Drôle de guerre. Initialement pensée comme une manœuvre périphérique pour contenir l’expansion allemande et soviétique, l’opération scandinave s’est transformée en enjeu diplomatique et militaire majeur, jusqu’à influencer la chute du gouvernement Daladier en mars 1940.
Ce projet avorté montre à quel point la France a cherché des alternatives face à l’offensive imminente de l’Allemagne nazie et comment les ressources naturelles comme les minerais sont stratégiques.